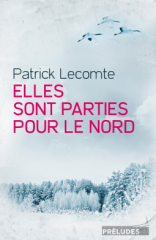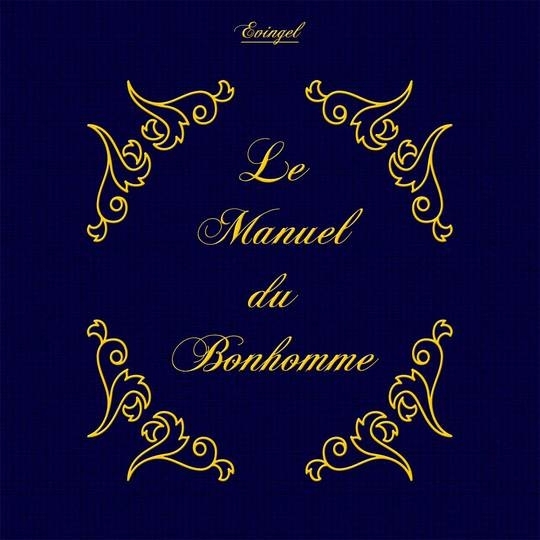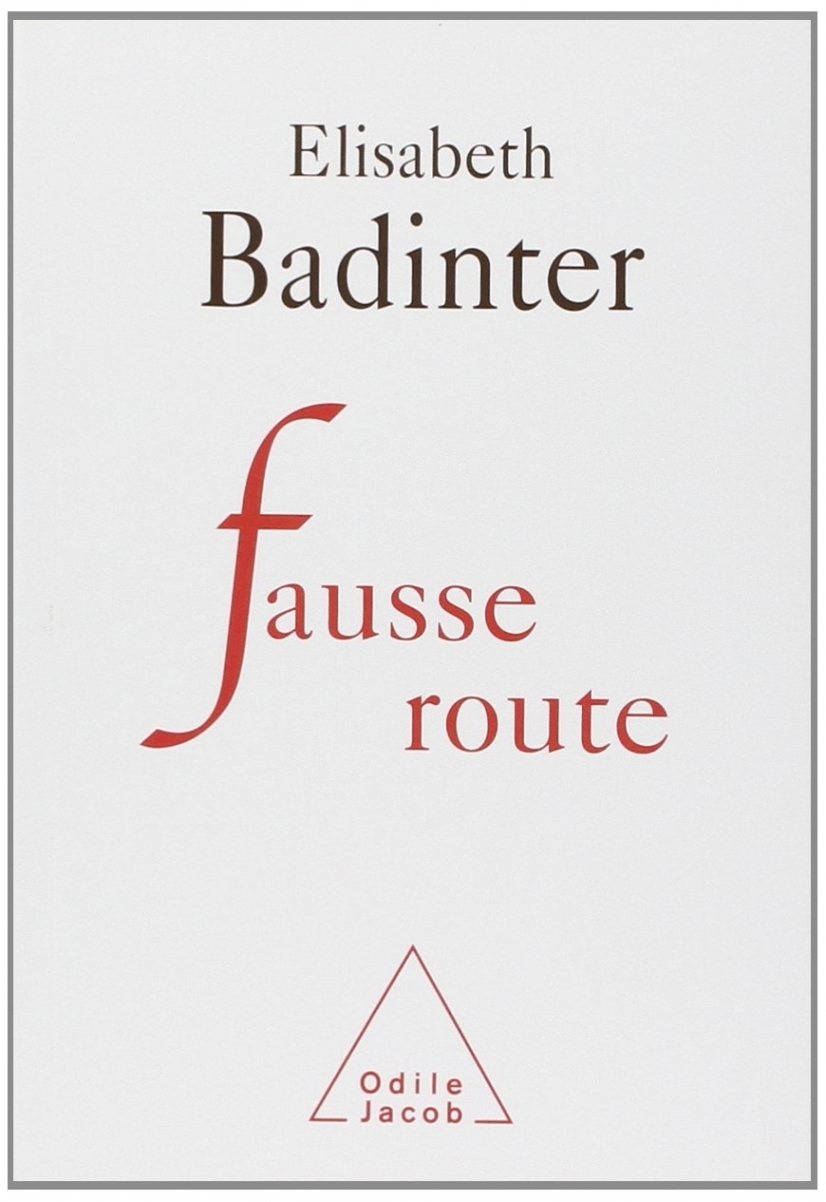Bande dessinée ••• Milo Manara, Le Parfum de l'invisible, Intégrale
Attache ta tuque ou le français dans tous ses États

La réforme de l’orthographe a été contre toute attente le sujet polémique de ces dernières semaines.
En décidant d’appliquer dès la rentrée prochaine un dépoussiérage général de la langue de Molière, qui avait été acté en 1990 (sic), les éditeurs de manuel scolaires ne s’attendaient sans doute pas à un tel ramdam. Le moins que l’on puisse dire est que la décision d’autoriser l’écriture du mot "oignon" en "ognon" ou "entraîner" en "entrainer" (par contre, contrairement à ce qui a été écrit un peu partout, les mots "mûr", "dû", "jeûne" et "sûr"continueront à porter leur accent) a fait du bruit dans Landerneau, que ce soit dans les réseaux sociaux (qui ont été les premiers à mettre le feu aux poudres), les médias traditionnels et jusque dans les repas de famille. Le bloggeur émet toutefois l’opinion que ce qui a sans doute choqué réside moins dans ces variantes orthographiques que dans une décision publique entendant répondre au fléau des fautes d’orthographe par une phonétisation même partielle de la langue écrite. Est-ce en simplifiant le français que la langue française sera mieux maîtrisée ? Beaucoup répondent par la négative, y voyant même une forme de "lâcheté".
La passion du débat sur cette langue française dans tous ses états rend d’autant plus intéressante la Semaine de la langue française et de la Francophonie qui a lieu du 12 au 20 mars 2016. Son mot d’ordre est : "Attache ta tuque !', 'C'est caillou !'… 1001 expressions à découvrir". Un vrai pied-de-nez à cette affaire de réforme de l’orthographe. Plusieurs personnalités, dont l’humoriste Jamel Debbouze, la journaliste Elsa Boublil ou encore l’écrivaine Marguerite Abouet ont accepté de parrainer cet événement.
Lors de ce rendez-vous des amoureux des mots, 1 500 manifestations seront organisées dans 70 pays : expositions, ateliers d’écriture, animations, spectacles, concours, dictées, slam…200 librairies seront mobilisées et près de 100 villes et villages sont partenaires de l’opération. Le bloggeur a noté quelques événements qui méritent le détour : le spectacle du conteur québécois Fred Pellerin au Théâtre de la Ville (le 12 mars), les Nuits du slam (du 17 au 20 mars), le grand concert de musique francophone dans les studios de Radio France (le 19 mars) et la Dictée pour les Nuls lors du Salon du Livre au cours duquel le 31e Prix du Jeune Écrivain de Langue Française sera remis (le 19 mars).
Cette année, la Semaine de la langue française et de la Francophonie proposera aussi de partir à la découverte du français parlé de Bruxelles à Kinshasa, de Genève à Montréal. Ce sera l’occasion de montrer les multiples visages du français dans les 70 États qui le pratiquent couramment. Loin d’être sclérosé, le français offre une richesse infinie. Ainsi, le "bleuet", qui désigne une petite fleur bleue en France, fait référence à une myrtille au Québec. Le "dîner" (ou "diner"?), qui correspond au repas du soir pour les habitants de l’Hexagone, désigne au contraire celui de midi en Belgique. De même, lorsque l’on "tombe amoureux" en France, on "tombe en amour" au Québec, on "glisse pour quelqu’un" au Cameroun et on est "bleu de quelqu’un" en Belgique.
Réseaux sociaux, télévisions, radios ou établissements culturels sont déjà sur le pont pour faire découvrir au grand public les subtilités de la langue française aux quatre coins du monde. "Attache ta tuque !", comme on le dit au Québec ("Attache ta tuque avec d'la broche, attache ta tuque pis tes bretelles"), dit autrement : "Attention, c’est parti !"
Semaine de la Langue française et de la Francophonie
Page Facebook de la Semaine de la Langue française