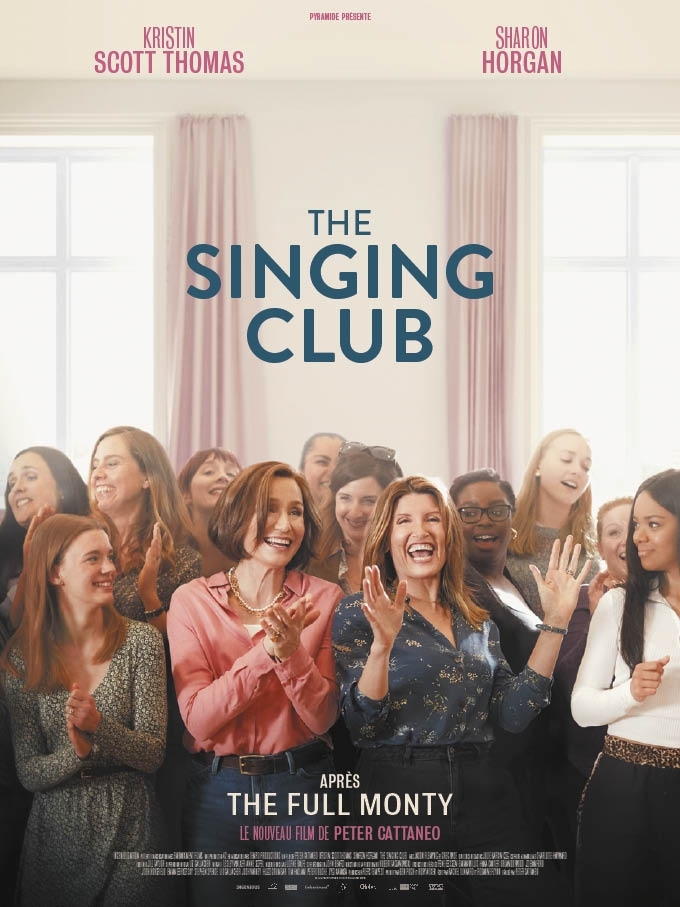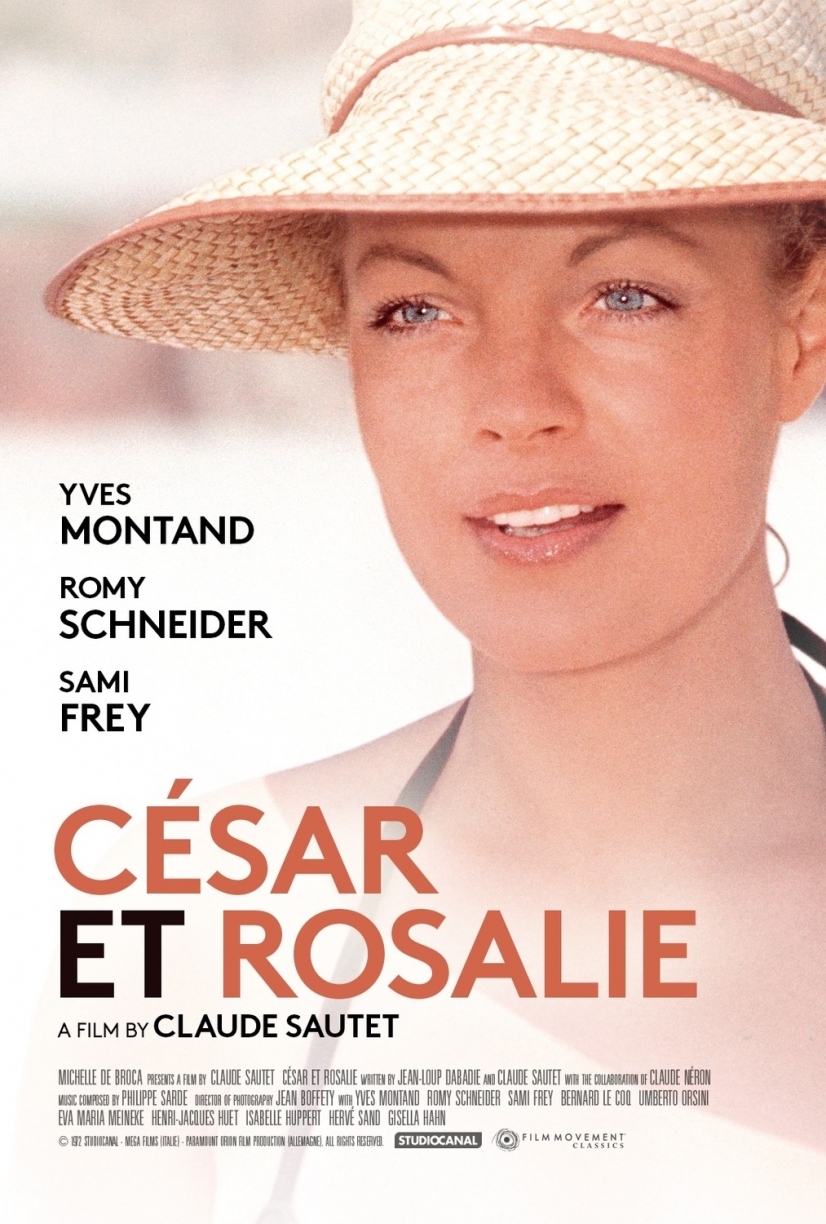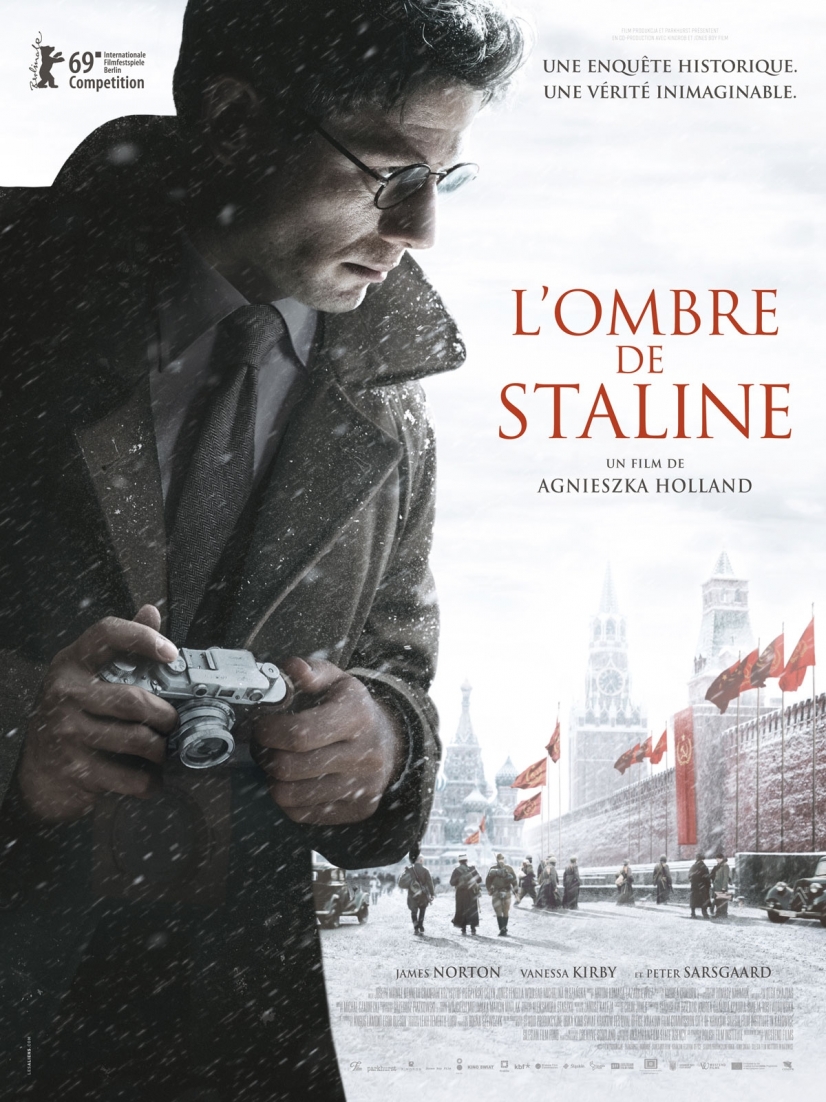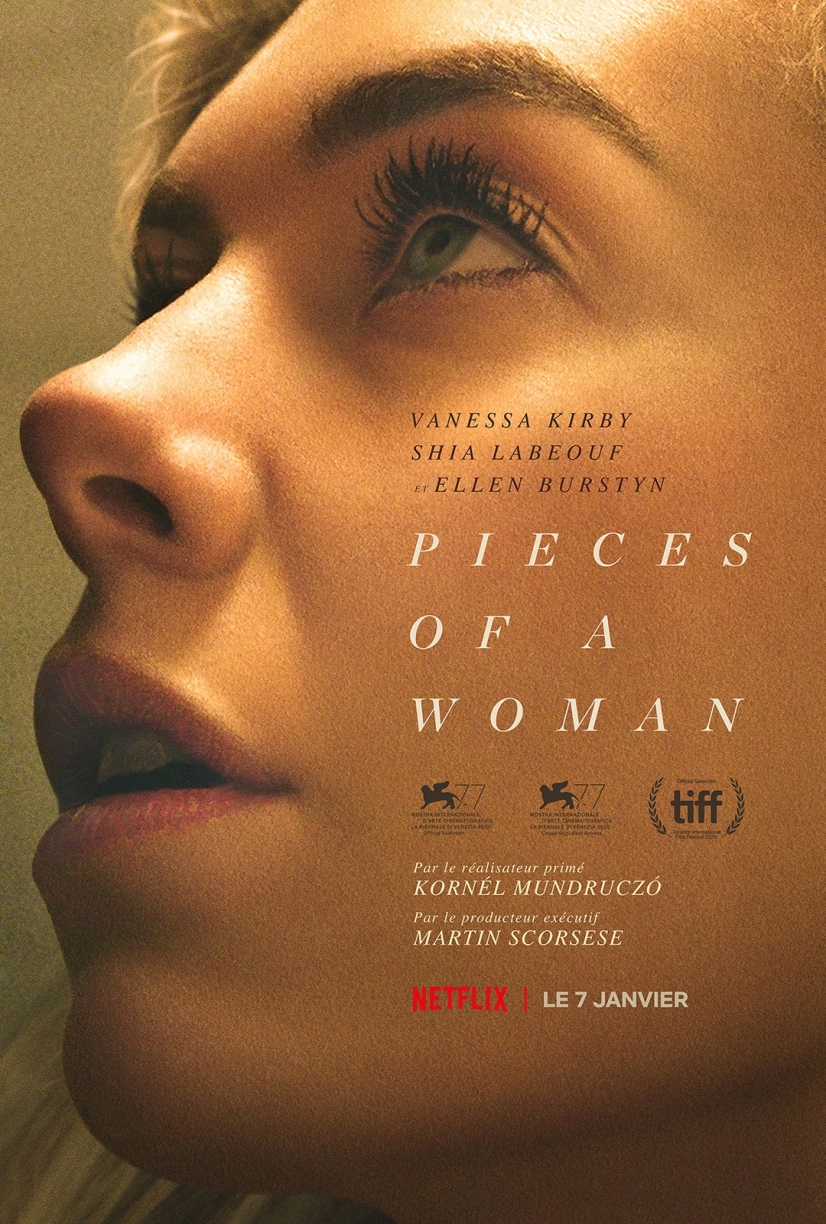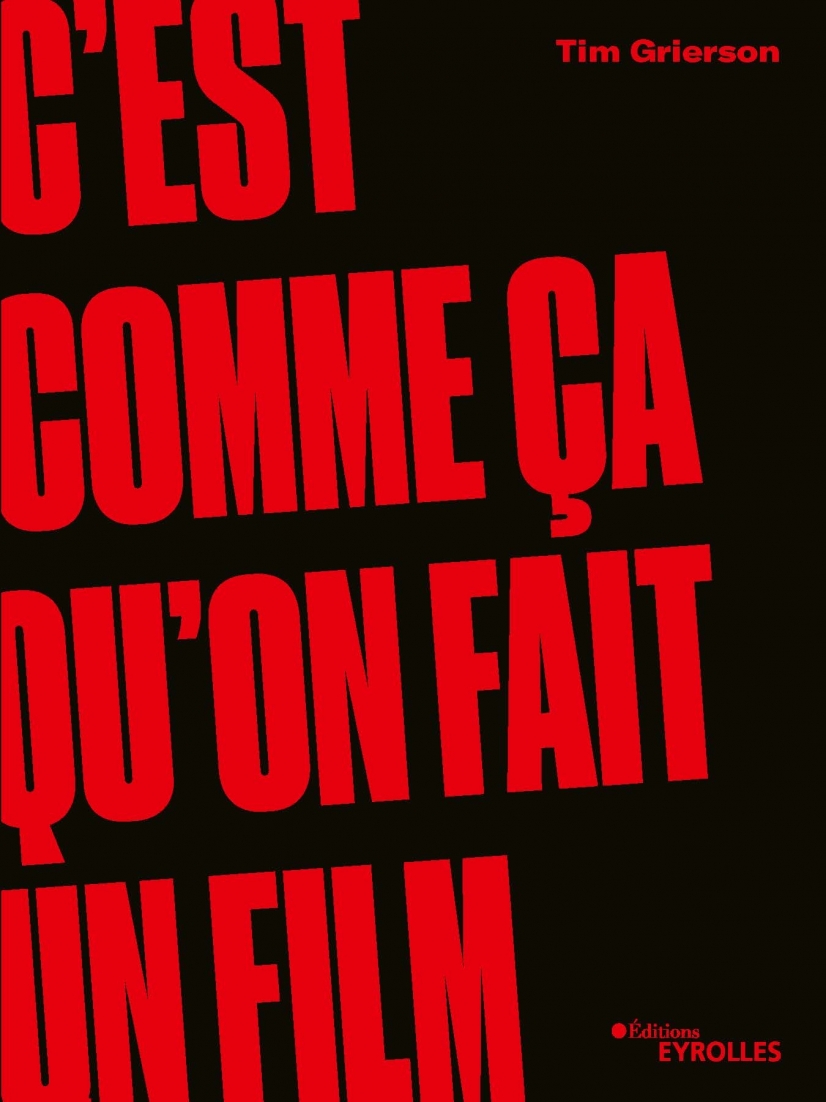Bande dessinée ••• Milo Manara, Le Parfum de l'invisible, Intégrale
Rangez bien votre frigo

C'est un film de 1967 que chronique aujourd'hui L’Œil du frigo. Seule dans la nuit (Wait Until Dark) est un thriller américain d'Audrey Hepburn. Encore un bon moment de cinéma. Avec, pour cette scène présentée ici, deux personnages clés : une aveugle et un frigo.
Quelques jours après Pâques, L’Œil du frigo s'émancipe des œufs et des cloches, pour vous présenter Seule dans la nuit de Terence Young, avec Audrey Hepburn dans le rôle de Suzy. Si vous ne connaissez pas ce film, sachez qu'elle est aveugle et qu'elle se défend contre un vrai psychopathe qui veut récupérer un objet qui est caché dans la maison. Un vrai jeu sur les savoirs s'établit devant nous et implique complètement le spectateur.
Le troisième personnage de ce film est le Frigo, comme quoi j'ai bien choisi cet objet. Sans lui vous n'auriez pas pu voir Suzy se battre contre l'homme qui la torture (et qui a mis un torchon sur les charnières du frigo) , elle qui est dans l'obscurité. Car, ce qui fait exister le film, c'est la petite lumière du frigo. Celle-là même qui lorsqu'on était petit nous intriguait : "Est ce que la lumière s'éteint quand on ferme la porte ?" Je vous rassure : certains adultes se posent encore la question. Heureusement que je n'ai pas choisi le point de vue du lave vaisselle dans le cinéma , je pense qu'il y aurait eu moins de films à vous présenter et moins de mystère. Depuis que j'ai commencé cette rubrique, j'en reviens pas du nombre de frigo qui se trouve dans les films, à croire que les cinéastes ont quelque chose à nous dire qu'on ne saisit pas !
Imaginez, 1967, date du film, c'est à dire il y a 50 ans : un frigo tenait le rôle central du film et pouvait résoudre tous les éclairages avec sa petite lampe. Quand je dis "éclairages", je pense évidemment au suspens de la fin, (ne voyez pas tout au premier degré non plus..). Non, je ne vous en dirai pas plus, sauf que ce cri est lumineux !
Bon en ce qui concerne le frigo, on n'y voit vraiment que du lait et quelques sauces encastrées sur la porte. Pas de quoi se faire un bon cassoulet. Faut dire qu'Audrey à la ligne alors même si on 1967 on ne mangeait pas encore bio (oui le bio ça fait toujours du bien...), elle mettait dans son frigo que des victuailles à faible pouvoir calorique. On peut noter néanmoins qu'il y avait un freezer en plein milieu, toujours utile pour quelques glaçons, mais l'ère Picard n'avait pas encore sonné !
En deux mots comme en un, si vous avez un objet à cacher, (non pas les œufs de Pâques) ne les cachez pas dans le frigo : les méchants y vont souvent surtout pour y voir plus clair, alors soyez prudent et rangez bien votre frigo, qui sait qui pourrait l'ouvrir devant une caméra !
ODF
Seule dans la nuit, thriller américain de Terence Young
avec Audrey Hepburn, Alan Arkin er Richard Crenna
1967, 108 mn
Voir aussi : "L’Œil du Frigo débarque sur Bla Bla Blog"
"Wait Until Dark Frigo"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !