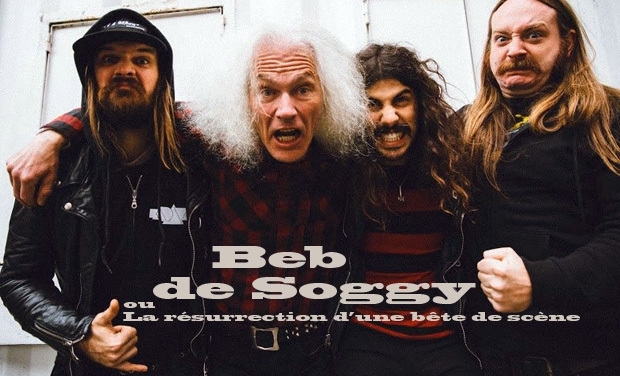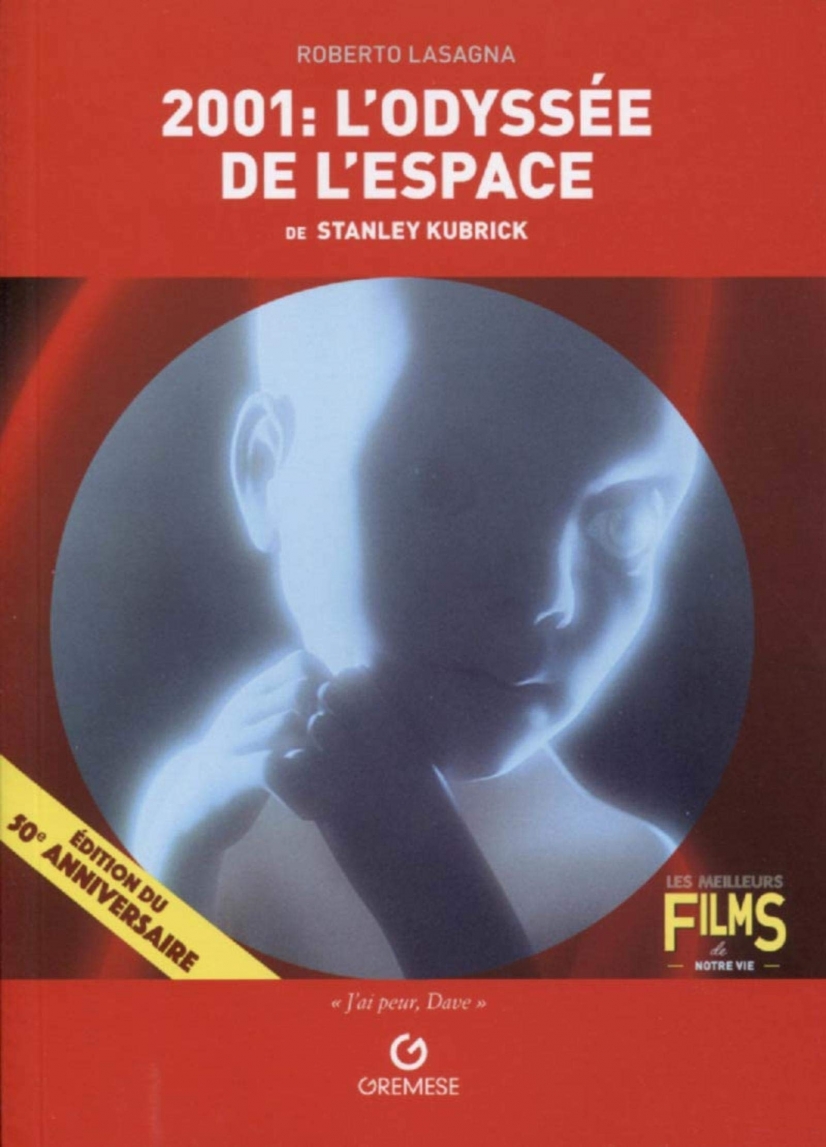Musique ••• Classique ••• De Grandval, Canal et Chaminade, L’âme résonnante, Hommage aux compositrices françaises
À pleines dents

Question : quel film de Steven Speilberg, classé comme l’un des 100 meilleurs films de l’histoire du cinéma par l’American Film Institute, le réalisateur américain tenta-t-il de faire retirer, au motif qu’il ne le sentait pas digne d’y figurer ? E.T. l'extra-terrestre ? La Couleur pourpre ? La Liste de Schindler ? Vous n’y êtes pas. Le long-métrage mythique et adulé que Spielberg considère comme une œuvre traumatisante est Jaws, sorti en France sous le titre des Dents de la Mer au cœur de l’été 1975.
François Grelet signe dans le magazine Première Classics un article solide et bien documenté ("Le jeune homme et la mer") sur ce film qui marqué l’histoire du cinéma, en même temps qu’il a inventé le concept du blockbuster. C’est peu de dire que l’auteur de la saga Indiana Jones n’assume toujours pas un film qui a définitivement lancé le jeune réalisateur sur une voie royale, après Duel (1971) puis le flop de Sugarland Express (1974) : "L’ex wonder-boy a continué malgré tout d’entretenir un rapport quasi traumatique à son premier succès comme s’il avait voulu le rayer de sa mémoire."
Il est vrai que le tournage des Dents de la Mer a été en soi une aventure infernale, commencée dans les couloirs d’une maison de production, la Zanuck/Brown Company, tout juste auréolée du succès de L’Arnaque (avec Robert Redford et Paul Newman) et qui mise en 1974 sur un certain Steven Spielberg, mais dont la sortie de Sugerland Express n’a pas eu le succès escompté, loin s'en faut. Or, voilà qu’un roman atterrit dans les bureaux des producteurs : Jaws (Mâchoires) de Peter Benchley. Les droits ont été achetés mais le film s’avère "infaisable" (nous sommes à des lieues des effets spéciaux d’aujourd’hui).
Pour Speilberg, ce challenge est excitant et bientôt le roman donne naissance à un premier scénario. La réécriture sera intensive, nous apprend François Grelet, avec plusieurs plumes s’acharnant à donner vie au requin tueur, malgré un roman qualifié de "sombre merde mal écrite" d’après Robert Shaw en personne, celui-là même qui endossera finalement le rôle de Quint, le chasseur de requins. Quelques noms étaient pressentis pour tenir le rôle du shérif Brody – Charlton Heston et Robert Duvall – mais c’est finalement Roy Scheider qui sera choisi.
"Sombre merde mal écrite"
Impossible de parler du tournage de Jaws sans s’arrêter sur le requin, qui sera l’un des personnages principaux de l’histoire. Comment montrer de la manière la plus réaliste la bête, alors que les effets numériques n’existent pas à l’époque ? Ramener un authentique squale de sept mètres dans les eaux américaines ? Filmer un animal depuis une cage minuscule avec un cascadeur de moins d’un mètre cinquante ? (sic) Spielberg choisit finalement les effets spéciaux et la construction d’un requin mécanique construit Bob Mattey, le concepteur du Nautilus pour le 20 000 Lieues sous les Mers de Richard Fleischer (1954). Un engin qui coûtera 600 000 dollars et qui ne fonctionnera qu’épisodiquement.
François Grelet décrit un tournage cauchemardesque sur l’île de Martha’s Vineyard, au sud de Boston : entre les régates estivales qui gênent les prises de vue, les critiques de Richard Dreyfuss pour un réalisateur encore novice de 25 ans, un budget qui a triplé, un tournage interminable et surtout les dysfonctionnements à répétition de "Bruce", le surnom du capricieux requin.
Jaws ne sera un film catastrophe que s’il ne rapporte pas d’argent, se lamente Spielberg au moment de la sortie du film. Sauf que les idées géniales du réalisateur, les astuces scénaristiques du film mais aussi la musique du film, avec les deux notes de musique les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma, vont faire des Dents de la Mer un triomphe hors du commun : 250 millions de dollars aux Etats-Unis et 450 millions dans le monde. Du jamais vu. Ce pur film de divertissement parviendra jusqu’aux Oscars, mais sans décrocher toutefois la récompense du meilleur film (attribué cette année-là à 1976 : Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman). Spielberg concourt la même année que Stanley Kubrick et son Barry Lyndon.
Après avoir lu ce focus sur Jaws, il ne reste plus qu’à voir et revoir l’histoire de l’animal le plus célèbre de l’histoire du cinéma, mis en image par Spielberg et en musique par John Williams. Ta ta… Ta ta... Ta ta ta ta ta ta ta...
François Grelet, "Le jeune homme et la mer", in Première Classics, juillet-septembre 2018
Steven Spielbert, Les Dents de la Mer, avec Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary et Murray Hamilton, Universal Pictures France, 1975, 2004, DVD, 120 mn
Voir aussi : "Les deux notes de musique les plus terrifiantes de l'histoire, au Grand Rex"