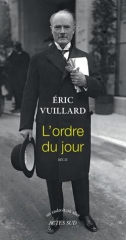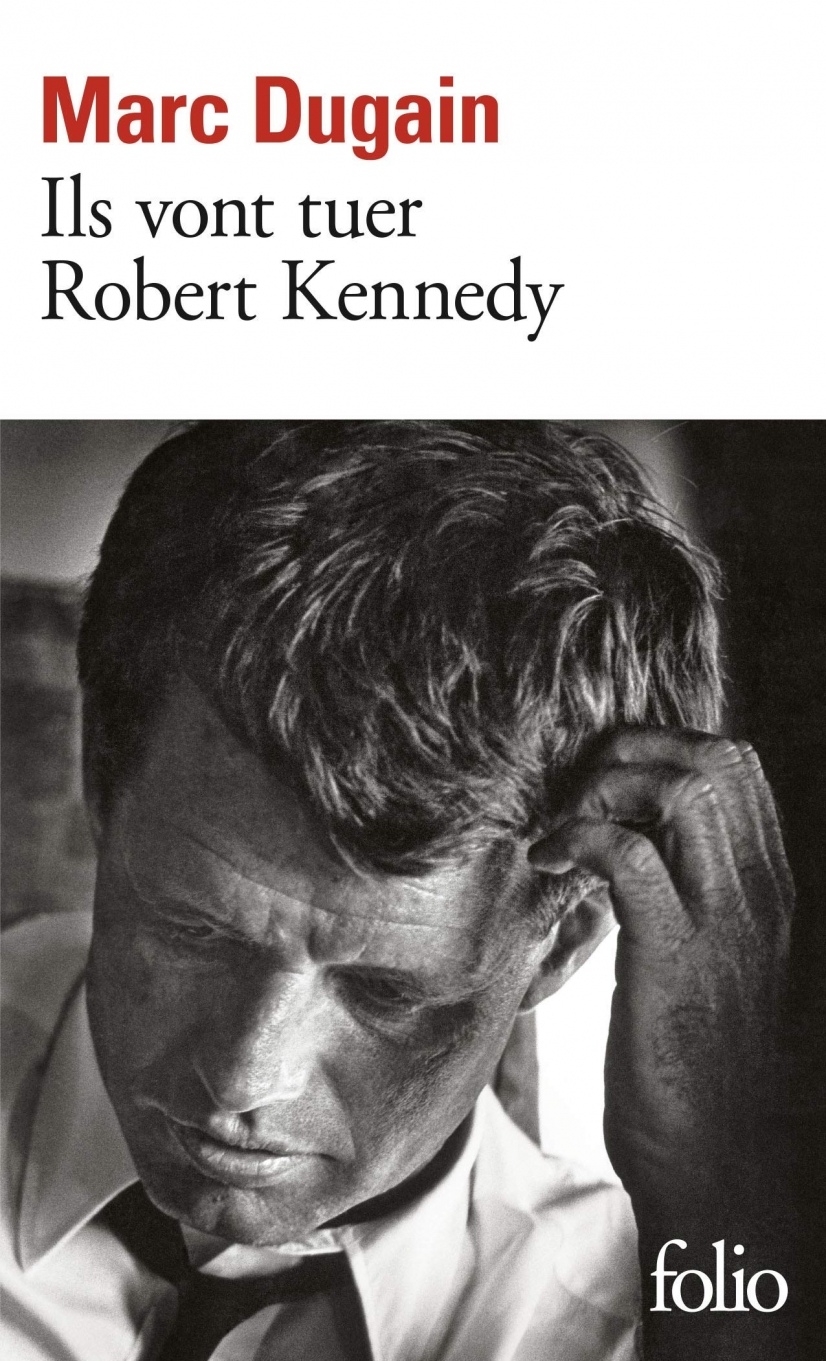Musique ••• Classique & jazz ••• Venerem, Strike
Le commerce des vivants
 Grand roman sur la guerre, cinglante satire sociale et portraits croisés d’anti-héros flamboyants, Au revoir Là-haut a réussi le tour de force de réconcilier grand public, critiques et milieu littéraire, qui ne s’est pas trompé en lui décernant le Prix Goncourt.
Grand roman sur la guerre, cinglante satire sociale et portraits croisés d’anti-héros flamboyants, Au revoir Là-haut a réussi le tour de force de réconcilier grand public, critiques et milieu littéraire, qui ne s’est pas trompé en lui décernant le Prix Goncourt.
Nous étions en 2013 à la sortie du livre de Pierre Lemaitre et les commémorations du centenaire de la Grande Guerre n’avaient pas commencé. Quatre ans plus tard, à quelques mois de la célébration du centenaire de l’armistice du 11 novembre, il n’est pas trop tard pour lire ou relire Au revoir Là-haut, d’autant plus que l’adaptation de et avec Albert Dupontel nous rappelle la force d’une histoire aussi simple que géniale.
Le 2 novembre 2018, à quelques jours de la fin des hostilités, le capitaine Henri d’Aulnay-Pradelle, un être "à la fois terriblement civilisé et foncièrement brutal," lance une charge aussi inutile que dangereuse contre les tranchées allemandes, moins pour son utilité tactique que pour sa gloriole personnelle. Parmi les victimes de l’attaque figurent Albert Maillard, un brave gars gentil, "de tempérament légèrement lymphatique," enterré vivant dans un trou d’obus avant d’en sortit miraculé, et surtout Édouard Péricourt qui deviendra une gueule cassée après avoir perdu la moitié de son visage. Une fois revenus parmi les vivants, le mutilé convainc Maillard de ne pas dévoiler son infirmité à sa sœur Madeleine et surtout à son père, l’homme d’affaire et millionnaire Marcel Péricourt. Aux yeux de tous, il doit figurer parmi les morts du conflit et tomber dans l’anonymat.
La guerre terminée, plus rien n’est comme avant. Fort de sa carrière d’officier, Henri d’Aulnay-Pradelle s’est enrichi grâce à l’appel d’offres de l’État sur les inhumations des poilus et les immenses cimetières. Il s’est également marié avec Madeleine Péricourt, ce qui ne m’empêche pas de la tromper sans vergogne. Pour Albert et Édouard, l’avenir est plus sombre : ils vivent dans une modeste pension, sans croire au lendemain. Alors qu’Albert traficote pour récupérer des fioles de morphine destinées à son ami, celui-ci s’évertue à cacher son visage défiguré à l’aide de masques aussi fantasmagoriques les uns que les autres. Un jour, Édouard dévoile à son ami un projet d’escroquerie qui doit les tirer d’affaire. Il met à profit ses talents de dessinateur pour mettre au point une supercherie sur le dos des morts de la Grande Guerre. Et contre toute attente, ce projet, aussi amoral et improbable soit-il, fonctionne au-delà de toutes les espérances.
Ces fameux masques, dadaïstes et surréalistes...
Pierre Lemaitre a écrit un roman brillant, facétieux et tragique. C’est en transportant le lecteur au tout début des années folles qu’il se fait le pourfendeur de toutes les guerres et tous les nationalismes. À y regarder de près, il n’y avait qu’Albert Dupontel pour rendre sur écran toute la verve de l’auteur et en faire une fresque grinçante et sombre. L’auteur de 9 Mois ferme a pris à bras le corps le pavé de 620 pages de Pierre Lemaitre, a resserré l’intrigue avec justesse sans trahir l’auteur – qui a d’ailleurs participé au scénario – et a enrichi l’histoire de cette escroquerie et de ces anciens soldats perdus de la Grande Guerre.
Qui d’autres que Dupontel pouvait interpréter le soldat Maillard, cet homme frustre, naïf mais courageux ? Laurent Lafitte, lui, excelle dans le rôle de cette fripouille qu’est Henri d’Aulnay-Pradelle. Quant à Nahuel Pérez-Biscayart, il campe un Édouard Péricourt brisé, muet mais capable de comportements audacieux. Gueule cassée condamnée à vivre en marge de son époque, et désireux de se couper de son père (Niels Arestrup), il devient paradoxalement la représentation vivante des années folles, cachant son visage cabossé et ses illusions tout autant détruites derrière des masques.
Parlons justement de ces fameux masques, dadaïstes et surréalistes... Cécile Kretschmar est la créatrice de ces accessoires à l’importance considérable. "Édouard ne les portait jamais deux fois, le nouveau chassait l’ancien qui était alors accroché avec ses congénères, sur les murs de l’appartement, comme des trophées de chasse ou la présentation de déguisements dans un magasin de travestis."
Citons enfin le personnage de Louise (la magnétique et toute jeune actrice Heloïse Balster) : celle qui devient la voix, les oreilles et l’assistante aux masques du fils Péricourt est intelligemment utilisée dans le film, jusqu’à devenir une protagoniste pleinement utilisée dans cette histoire de commerce des vivants sur les morts.
Roman proche de la perfection, Au revoir Là-haut – dont le titre est un hommage à la dernière phrase de Jean Blanchard, fusillé le 4 décembre 1914 – est aussi l’exemple d’une adaptation réussie à montrer dans toutes les écoles de cinéma. Un grand livre et un grand film. À voir et à lire, ou inversement.
Pierre Lemaitre, Au Revoir Là-haut, éd. Albin Michel, 2013, 620 p.
Au Revoir Là-haut, d’Albert Dupontel, avec Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nahuel Pérez Biscayart, Niels Arestrup, Émilie Dequenne, Mélanie Thierry et Heloïse Balster,
2017, 115 mn
Voir aussi : "Aussies au front"