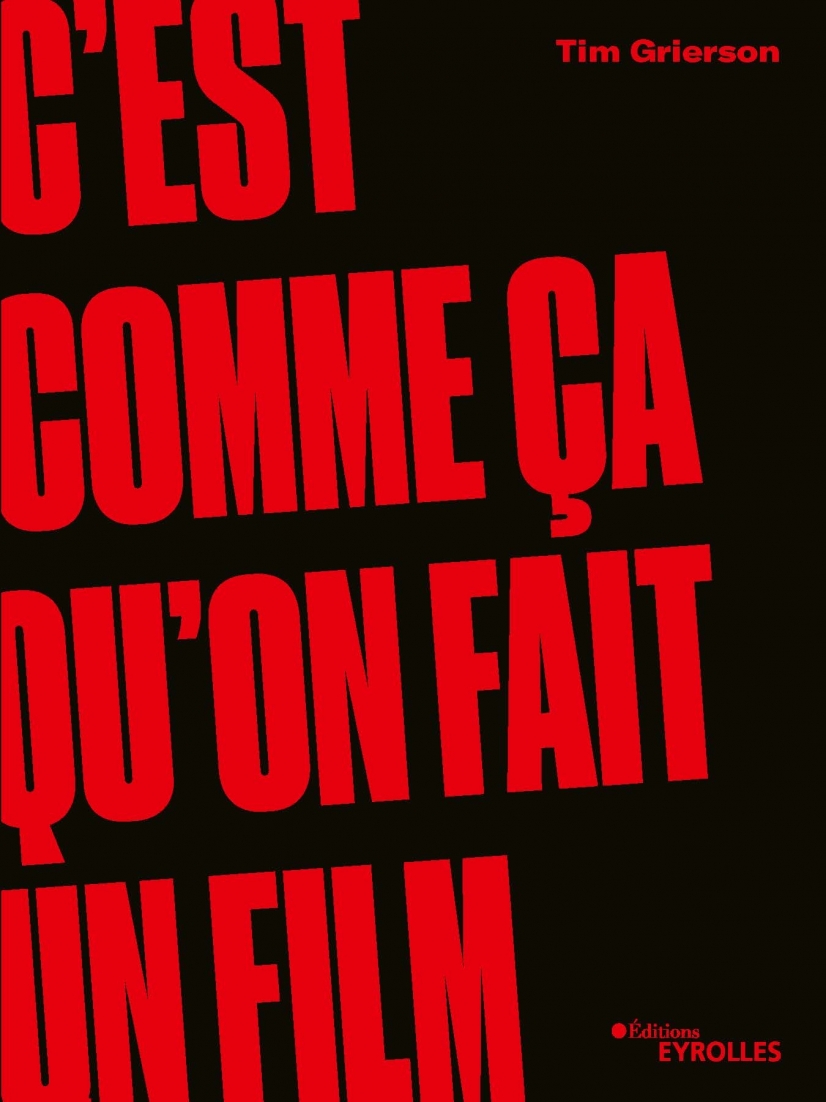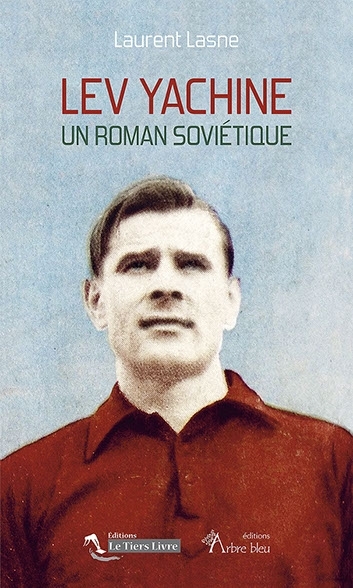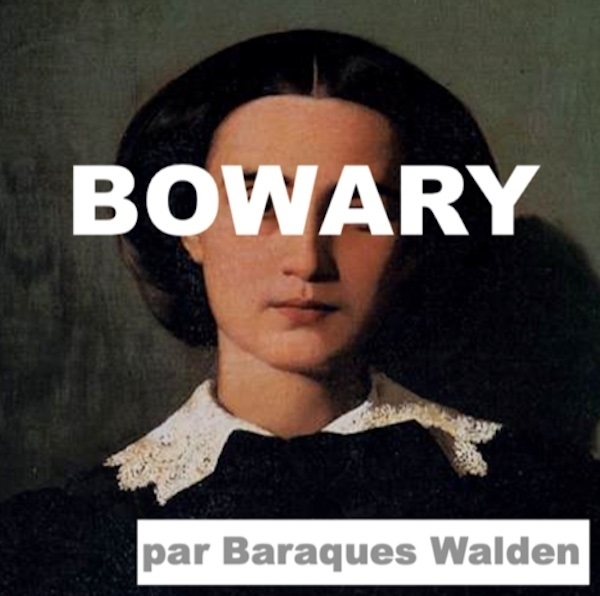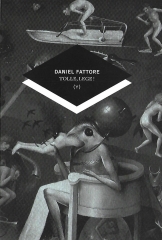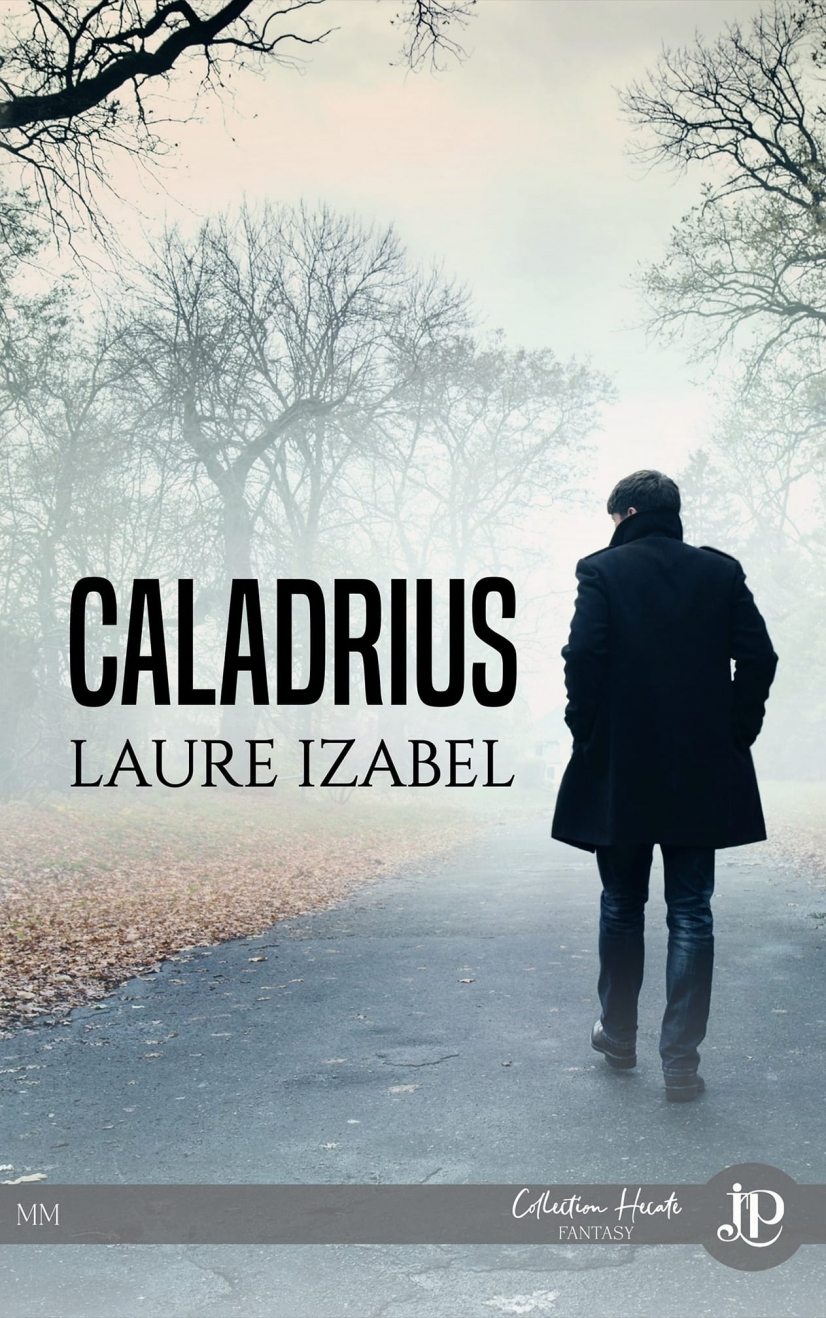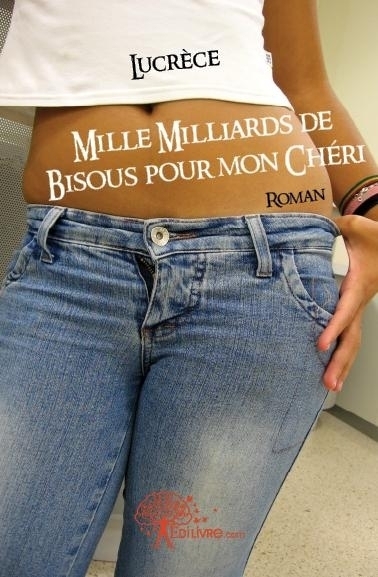Musique ••• Classique ••• Jean-Sébastien Bach, Le clavier bien tempéré, Livre II, Vincent Bernhardt
Amandine Deslandes : "Je pense que l’on a fait de Simone Veil une icône féministe contre sa volonté"

Nous avions parlé il y a quelques semaines de la biographie de Simone Veil par Amandine Deslandes. Cet ouvrage passionnant sur une femme politique exceptionnelle à plus d'un tire méritait que l'on s'y attarde de nouveau. Une interview d'Amandine Deslandes s'imposait. L'auteure de Simone Veil, Mille Vies, Un Destin (éd. City) a bien voulu répondre à quelques questions.
Bla Bla Blog – Bonjour Amandine. Vous êtes l’auteure d’une biographie sur Simone Veil. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette entreprise, que l’on imagine ardue ?
Amandine Deslandes – Je dois avouer que j’ai toujours voulu écrire, et secrètement rêvé d’être publiée. Alors, j’écrivais, sans trop en parler à personne, à part mon associé, qui est également mon compagnon dans la vie. Nous avons eu l’occasion de rencontrer dans le cadre de notre travail un membre de City Éditions. Ils ont une partie de leur activité spécialisée sur les biographies et les témoignages. Alors, nous nous sommes mis en quête d’un thème. Avec le tournage d’un film biopic, nous avons choisi d’écrire sur Madame Veil. Je me suis très vite éprise du sujet, à la fois sur les sujets en lien avec la protection sociale et sur la question du droit des femmes. C’était si naturel de raconter cette grande dame ! C’est vrai que c’était du sport d’écrire en seulement trois mois, surtout avec ma vie professionnelle en parallèle, mais c’était aussi très galvanisant !
BBB – Quelles ont été vos sources ?
AD – L’écriture de cette biographie a nécessité un très gros travail de recherche. J’ai d’abord lu tous les ouvrages parus sur sa vie. Ensuite, il s’est agi de compiler des archives. Aujourd’hui avec les moyens dont on dispose, l’accès à l’information est facilité. J’ai regardé les vidéos archives de l’INA, comme les anciens débats télévisés ou encore Le Divan d’Henri Chapier, puis lu de très nombreux articles, dans Paris Match, Le Figaro, Le Monde, Le Point, et tant d’autres. J’ai également écouté des podcasts parus au moment de sa disparition. J’ai beaucoup travaillé à base de photos ou encore de cartes pour me représenter les lieux et les personnes, et pouvoir les décrire avec justesse. Je dirais en fait que, le plus difficile, c’est presque de savoir arrêter les recherches !
BBB – Le lecteur sera sans doute surpris de voir que la période de sa vie la plus sombre, celle de la déportation, fait l’objet d’une vingtaine de pages alors qu’il s’agit d’une période capitale dans sa vie. Est-ce par manque de sources ?
AD – Je ne crois pas que cela soit le sujet. Je crois avoir trouvé ce dont j’avais besoin pour travailler cette partie terrible de sa vie. Toutefois, cela a, proportionnellement à la durée de sa vie, représentée, certes une période très sombre, mais relativement courte. Je ne voulais pas non plus la résumer à sa judéité. Cela ne me semblait pas la définir, et encore moins être conforme à ce qu’elle aurait probablement souhaité.
BBB – Simone Veil semble avoir d’ailleurs longtemps été discrète cette période.
AD – C’est une horreur. Je crois que personne n’est à même de comprendre la réalité de ce que les déportés ont vécu. Cela a été très dur pour moi d’écrire sur le sujet, et aujourd’hui quand j’en parle, j’ai toujours la gorge qui se noue. Alors, quand on l’a vécu, je n’ose même pas imaginer. Elle a vécu un traumatisme terrible, et je crois qu’elle n’avait pas envie d’être réduite à cela, ce qui ne l’a pas empêché bien au contraire d’œuvrer pour le devoir de mémoire.
"Le plus difficile, c’est presque de savoir arrêter les recherches !"
BBB – À la lecture de votre biographie, il apparaît contre toute attente que c’est la loi sur l’adoption sur laquelle elle a travaillé qui est sa plus grande fierté. Avez-vous vous-même été surprise par son regret que ce ne soit pas cette loi qui porte le nom de « Veil » mais la loi sur l’IVG ?
AD – Il me semble qu’elle n’était pas, en son for intérieur, pro-avortement. Elle pensait cependant qu’il s’agissait d’une question de santé publique et de droit. Il était indispensable pour elle de mettre fin à cette hypocrisie de société et de permettre une réelle avancée en matière des droits de la femme. Toute sa vie, elle a œuvré à la défense du droit de l’être humain. Je crois qu’elle aurait aimé que la loi sur l’adoption porte son nom, elle la considérait comme un bel aboutissement de son travail de juriste.
BBB – N’y a-t-il pas une énigme "Simone Veil" ? Et cette femme d’un milieu bourgeois plutôt conservateur qui donne naissance à l’une des plus grandes révolutions sociétales du XXe siècle ?
AD – Je ne pense pas que l’on puisse réduire Simone Veil à un simple paradoxe de société. Elle était certes d’un milieu bourgeois et mondain, mais elle avait une forme de rébellion en elle. C’était un esprit libre. Elle était capable de se fondre dans le Tout-Paris tout autant que de s’emporter contre une injustice criante. Elle cherchait en toute chose un équilibre en rejetant les clivages partisans. Je crois que c’est la marque de fabrique de son engagement, et c’est un point dans lequel je me retrouve profondément.
BBB – Vous insistez aussi sur son engagement européen. Qu’est-ce qui reste aujourd’hui de son héritage européen ?
AD – Elle a été une Européenne convaincue très tôt. C’est ainsi qu’elle a suivi son mari muté en Allemagne, car elle croyait profondément en l’importance de la réconciliation. Elle a été la première femme Président du parlement européen. C’est en soi un héritage. Bien que son passage à la tête de l’assemblée ait été court, elle a beaucoup œuvré pour la construction européenne. C’est elle qui a fait rayonner le parlement et lui a donné la crédibilité face aux autres instances européennes dont il dispose encore aujourd’hui.
BBB – Parlez-nous de ses relations avec Jacques Chirac, assez complexes d’après ce que l’on peut lire.
AD – Complexes, je ne sais pas. Ambivalentes, certainement. Il l’a beaucoup soutenu, et il avait une affection particulière pour elle. Il l’appelait « Poussinette ». En même temps, c’était un ambitieux. Je cite dans le livre une phrase qu’elle répète à son sujet : "Jacques Chirac et moi sommes des amis. Mais l’amitié et la politique sont deux choses différentes." Je pense qu’ils ne partageaient pas exactement la même vision de la politique. Elle était profondément centriste, et lui n’était pas, ce que l’on pourrait appeler un homme de compromis !
BBB – Simone Veil est décédée en juin 2017, soit quelques mois seulement avant le déclenchement du mouvement #MeToo. D’après vous, comment aurait-elle réagirait, elle qui est une des figures du féminisme français ?
AD – Je pense que l’on en a fait une icône féministe contre sa volonté. Elle ne se revendiquait pas de ce mouvement. Il m’apparait qu’elle était avant tout un défenseur des droits, des droits de la femme en particulier. Elle pensait d’ailleurs à la fin de sa vie que le chemin était loin d’être terminé, et qu’il ne fallait pas oublier d’où l’on venait. La mémoire, encore et toujours. Je ne suis pas certaine qu’elle aurait apprécié ce mouvement. Elle a incité les femmes à faire appliquer leurs droits. Cependant, elle était, en toutes circonstances, pour la justice et le respect de l’être humain. Elle n’aurait pas probablement cautionné l’utilisation parfois déviante des réseaux sociaux.
BBB – Merci d’avoir répondu à ces questions.
AD – Merci à vous de m’avoir donné l’opportunité de partager ma passion de cette grande dame !
Amandine Deslandes, Simone Veil, Mille Vies, Un Destin, éd. City, 2021
https://www.amandinedeslandes.fr
https://www.facebook.com/amandine.deslandes.marseille
http://www.city-editions.com
Voir aussi : "En suivant la route de Simone Veil"
Photo : © Yohan Brandt
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !