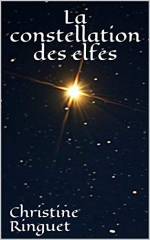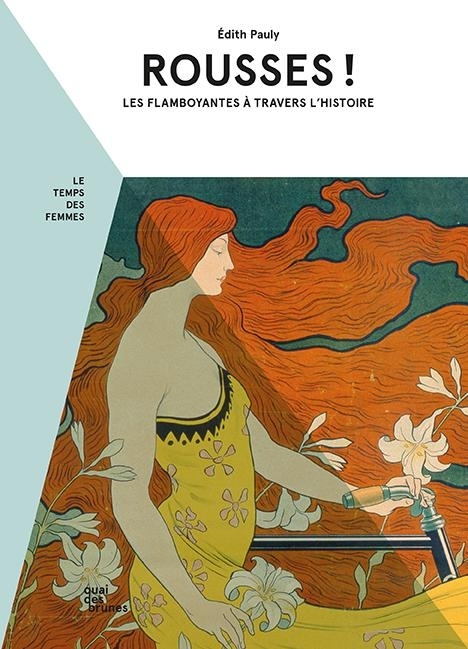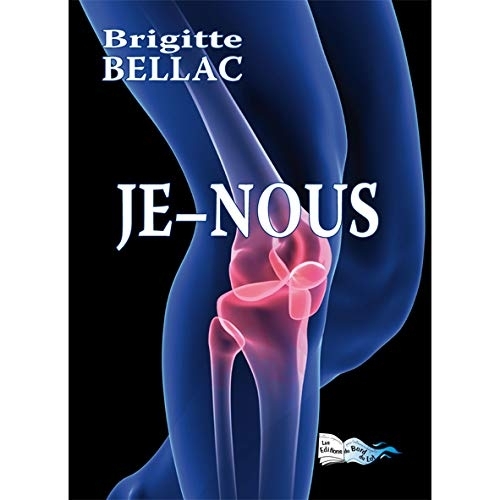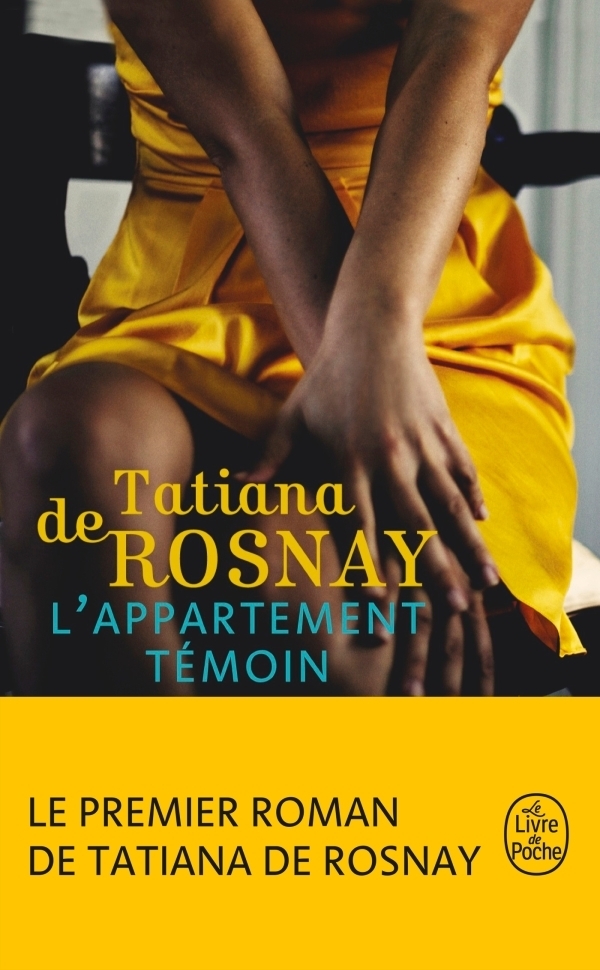Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage
Au cœur d’une femme

Paru chez Plon en 1998, avant de faire l’objet d’une réédition dix ans plus tard, Le Cœur d’une Autre est le troisième roman de Tatiana de Rosnay. Tout comme L’Appartement témoin, l’auteure s’intéresse à la quête d’un homme paumé, un anti-héros que le destin fait basculer dans une histoire hors-norme.
Bruce Boutard est un antipathique et fieffé misanthrope, divorcé et à la vie sans aspérité autre que son fils Mathieu : "J'avais les habitudes lugubres d'une vieille fille ; ces vieilles filles velues à bouillottes qui se parlent seules à voix basse, qui portent des chaussettes de laine pour dormir et leur Damart même quand il fait chaud. Rien de tragique, pourrait-on dire. Rien d'extraordinaire. Cependant - hélas ! -, il s'avère que je suis un homme." Un être franchement antipathique que le lecteur va pourtant suivre avec passion.
Suite à un malaise, Bruce apprend qu’il souffre d’une maladie du cœur et qu’il doit être greffé en urgence. Au bout d’une attente interminable, une bonne nouvelle arrive et Bruce reçoit un nouvel organe. De retour de l’hôpital, l’ancien homme acariâtre et misogyne se trouve changé, tant dans le caractère, que la sensibilité et les goûts. Un voyage en Italie avec son fils le convainc que son nouveau cœur l’a profondément transformé. Il parvient à connaître l’identité de la donneuse, décédée la veille de sa greffe. Elle se nommait Constance Delambre et semble maintenant revivre "à travers ce cœur transplanté." La vie du greffé est transformée à jamais. Bruce n’a désormais qu’une obsession : savoir qui est cette femme à qui appartenait son nouveau cœur, un cœur qui semble être possédé d’une mémoire.
Une quête impossible
C’est une quête de la vérité qui est au centre de l’histoire, une quête au départ impossible car, comme le rappelle l’auteure, le don d’organe est anonyme. Il fallait une astuce de romancière pour permettre à Bruce de se mettre en piste : la rencontre avec Joséphine – de nouveau une histoire de cœur – va s’avérer décisive.
Comme pour L’Appartement témoin, c’est en Italie que se déroule l’enquête sur la piste de Constance, mais qui est aussi celle du peintre Paolo Ucello et d’un mystérieux tableau. C’est l’occasion pour Tatiana de Rosnay de proposer de belles pages sur l’artiste florentin, notamment cette description de La Bataille de San Romano : "C’était un grand tableau sombre aux teintes ocre et bistre, peint avec une vigueur candide et une rigueur des lignes qui me fascina. Intrigué par le tumulte discipliné de l’œuvre, la symétrie parfaite des lances et des plumes plantées dans les armets, il me semblait que je me trouvais transporté au milieu d’une bataille. J’entendais la clameur sourde d’une lutte, le choc de boucliers contre armures, les bruits métalliques des cuirasses, des épées, des glaives, les hennissements des chevaux enchevêtrés, harnachés de pourpre et d’or, dont deux gisaient au sol, l’un agonisant, l’autre figé par la mort… Derrière la violence de la bataille s’étirait un paysage tranquille; des vendangeurs travaillaient dans les vignes, et un chien poursuivait des lièvres à travers champs."
Comme l’explique Tatiana de Rosnay dans la préface écrite en 2011 de ce roman, ce n’est pas un lieu qui déclenche l’intrigue mais "un cœur qui, en changeant de corps, va se remettre à palpiter dans une nouvelle poitrine, encore empreint d’émotions antérieures." La seconde préface de cette édition, de Joël de Rosnay, aborde le thème de la greffe sous le regard du scientifique : "Une greffe de cœur peut-elle changer la psychologie et le comportement d’une personne ?" se demande-t-il. Un début de réponse est donnée par l’épigénétique, poursuit-il : une discipline récente qui tendrait à montrer que la base du livre de sa fille Tatiana est loin d’être absurde.
Le lecteur oublie rapidement les doutes sur les effets de ce nouvel organe et se laisse porter par cette histoire de "mémoire neuve" – pour reprendre un titre de Dominique A. Il suit les pas d’un Bruce transformé en vrai beau personnage romanesque, grâce à une mystérieuse donneuse qu’il n’aurait jamais dû connaître et qui lui a fait pourtant don du plus grand des cadeaux : "Je lui dois la vie, et le goût de la vie. Comment lui dire merci, puisqu'elle n'est plus sur terre ?"
Tatiana de Rosnay, Le Cœur d’une Autre
éd. Le Livre de Poche, 1998, éd. Héloïse d’Ormesson, 2009, 282 p.
http://www.tatianaderosnay.com
Voir aussi : "Tatiana de Rosnay, son œuvre"
"Premiers fantômes"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !