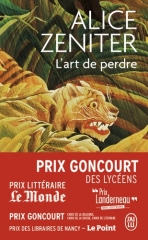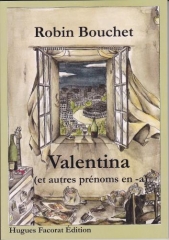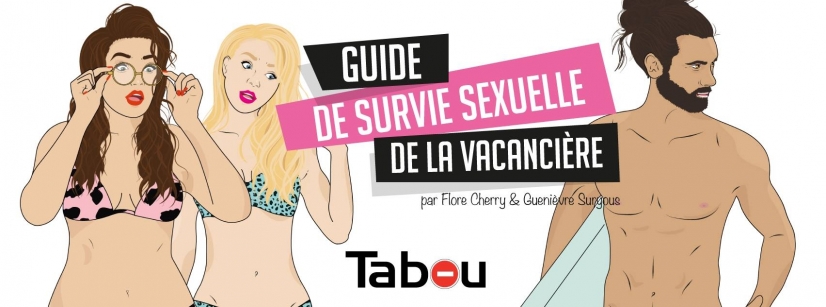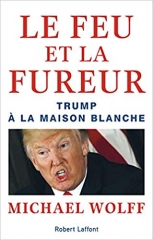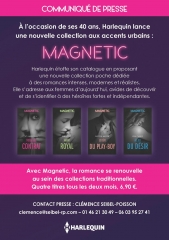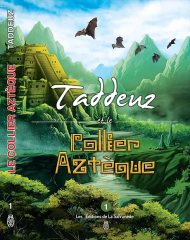Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage
L’ennui avec les princesses

Stella Tanagra, la petite princesse de l’érotisme, est de retour, cette fois dans un roman, Les Dessous de l’Innocence (éd. Tabou). On l’avait laissée avec Sexe primé, des nouvelles à la fois efficaces et aventurières, parvenant à décliner l’érotisme sous toutes ses variantes, le déflorant, le libérant et le faisant exploser et gicler de manière la plus inattendue qui soit : un vrai exercice de style par une auteure qui s’annonce comme une des plumes prometteuses de la littérature érotique.
Dans son premier roman, Les Dessous de l’Innocence, Stella Tanagra nous parle d’une autre princesse des temps modernes, Tilda Lornat. Cette jeune professeure spécialisée, à qui rien ne manque apparemment, ne respire que pour son Thomas, un militaire souvent en mission et la laissant (trop) souvent seule dans une belle mais froide demeure bourgeoise. L’ennui avec les princesses c’est que le bovarysme n’est jamais très loin : "Les jours sont longs lorsque l’on est institutrice dans un établissement pour enfants handicapés… Cette vie aurait pu être une romance idyllique. Tous les ingrédients y sont."
Tilda rêve sa vie plus qu'elle ne vit son rêve, qui semble n’être qu’un triste conte de fée au cours de journées rythmées par l’attente du soldat parti à la guerre et quelques travaux ménagers : "La première impression donne le ton de la suite des événements. Elle n’omet donc aucune infime dorure à reluire. Cendrillon danse avec son balai pour qu’incessamment son hall parqueté puisse accueillir son corps étendu et trémulant sous les coups de reins du prince charmant aux allures de bad boy." Le conte de fée n’en est finalement pas un : "La table est tapissée d’une nappe rouge. Le service disposé brille sous l’éclat du feu de cheminée se reflétant des verres aux couverts. Même les chandelles trônent aux abords de la table. Tilda a toujours voulu être cette princesse. Cela dit, les contes de fées n’ont jamais sous-entendu que la princesse peut avoir une libido débordante, ni indiqué la manière de l’assouvir."
Tilda rêve sa vie plus qu'elle ne vit son rêve
Ses fantasmes viennent égayer des journées mornes, fantasmes de plus en sophistiquées et qui, bientôt, vont prendre corps en la personne d’un séduisant kiné, Edgar. Il arrive ce qui devait arriver dans la vie de cette "petite fille modèle..."
Stella Tanagra use de sa langue tonique, un mélange de verdeur, de lyrisme et de descriptions triviales, pour entrer dans l’intimité de Tilda et de ses étreintes de succube : "À l’image d’une pucelle, elle arpente avec exaltation, les plaisirs de la chair. Son corps ressuscité répond aux provocations de son amant de quelques coups de reins réflectifs." Les dialogues secs et empruntés entre les personnages sont ceux de simulacres sociaux auxquels répondent la seule vérité qui soit : celle des corps qui se cherchent, qui se plaquent les uns les autres et qui se livrent sans artifice, loin des conventions sociales. "Sous le joug de diktats ancestraux réduisant les rôles sociaux des hommes et des femmes, Tilda se meurt étouffée sous ses désirs qui ne devraient rien avoir d’interdit."
Stella Tanagra ouvre la dernière partie du livre avec le retour du soldat que Tilda n’attendait plus. Après La Belle au Bois Dormant – quoique bien réveillée après les baisers d’Edgar – c’est Lady Chatterley accueillant son héros de soldat, un "colosse au pied d’argile" brisé et peinant à assouvir les fantasmes de sa femme. Reste à savoir qui jouera le rôle du garde-forestier... À moins que la jeune femme ne doive se résoudre à fermer la parenthèse de ses intercades...
Les Dessous de l’Innocence se déflore d’abord doucement, dans une torpeur érotique et tropicale. Le lecteur se coule dans la vie paresseuse et languide d’une jeune professeur assaillie par ses pulsions et ses fantasmes. Puis, par paliers successifs, Stella Tanagra parvient à électriser son premier roman et à faire monter la pression, jusqu’à un dernier chapitre épicé comme seule elle sait le faire.
Stella Tanagra, Les Dessous de l’Innocence, éd. Tabou, 2018, 160 p.
http://stellatanagra.com
Voir aussi : "Ma chair et tendre"