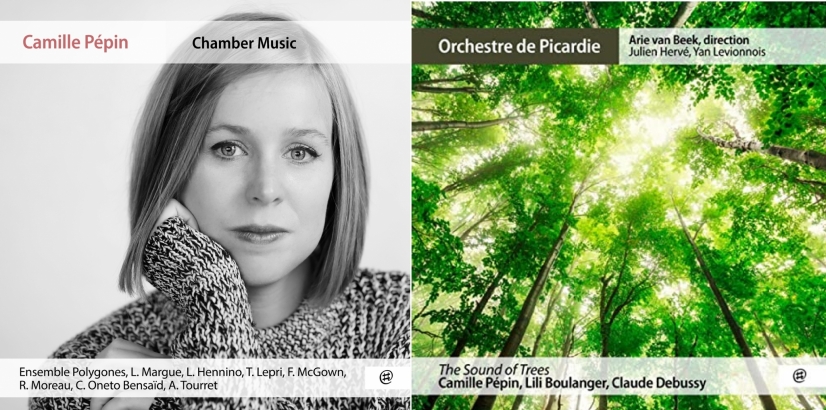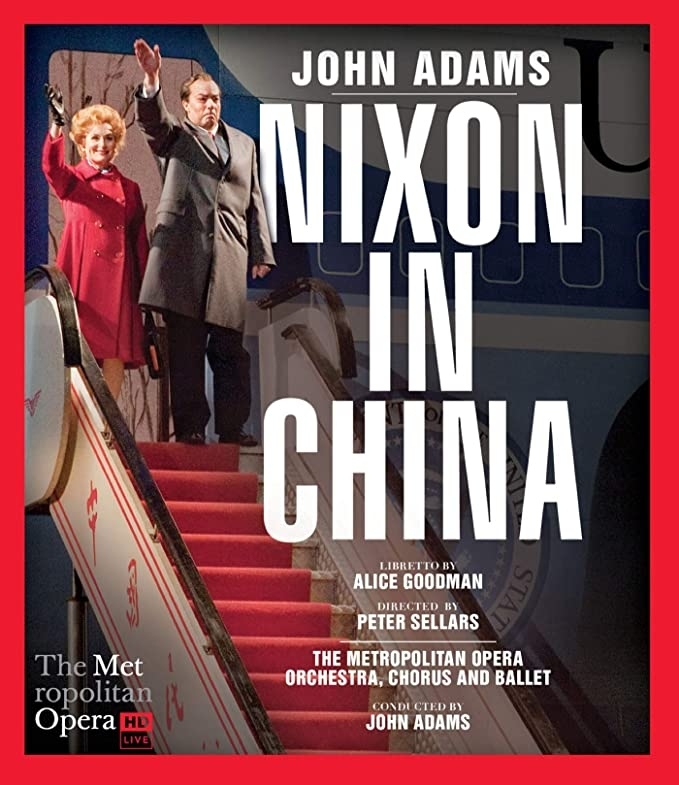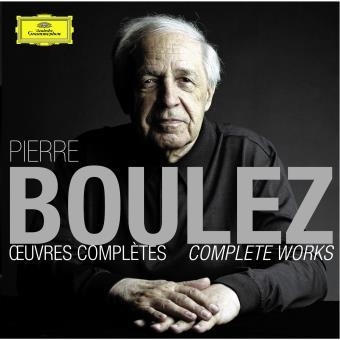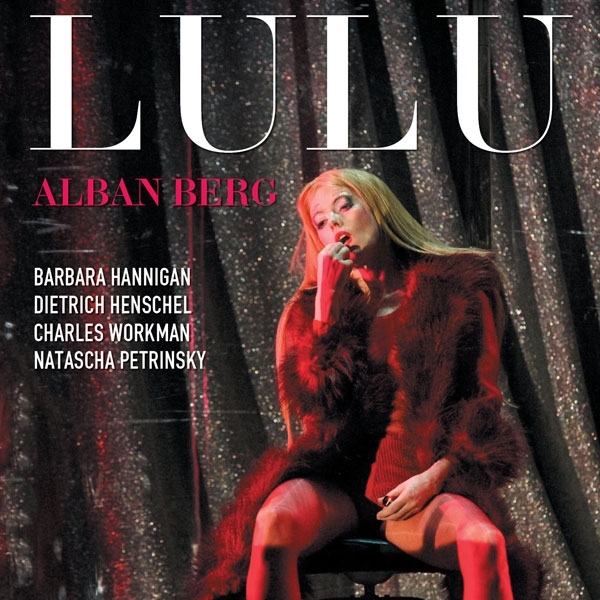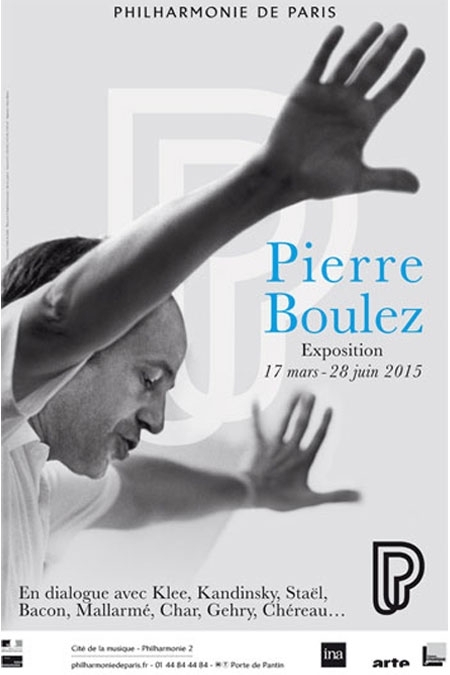Livre ••• Essai & cinéma ••• Philippe Collinet, Films de famille, Complexes familiaux
En suivant le fil de Khatia Buniatishvili

Dans l’univers du classique, Khatia Buniatishvili fait partie des très grandes stars, à côté de figures comme Lang Lang ou Yuja Wang, pianistes comme elle.
Aussi française que géorgienne, son pays d’origine, Khatia Buniatishvili a sorti il y a quelques semaines sa compilation, Labyrinth, que la musicienne décrit ainsi : "Le labyrinthe est notre esprit, souvenirs de notre enfance dans une perspective d’adulte… Le labyrinthe est notre destin et notre création."
La pianiste laisse de côté les grands incontournables de cet instrument – si l’on excepte la première Gymnopédie de Satie, la Badinerie enlevée et jazzy de Bach et le Prélude op. 28/4 de Chopin – au profit de morceaux choisis avec soin pour illustrer les aspirations de l’instrumentiste dont le public d’admirateurs ne cesse de croître : "les rêves brisés" ("Le thème de Deborah"), "la Mère Nature" (la "Suite Orchestrale" de Bach), les émois adolescents (une "Vocalise" de Rachmaninoff), l’amour ("La Javanaise") ou la consolation (Liszt).
Dans une pérégrination mêlant romantisme, classicisme, modernisme, audace, revisites et clins d’œil, Khatia Buniatishvili s’amuse à sauter à pieds joints d’un siècle et d’une époque à l’autre, sans se soucier des époques et des styles : sa version funèbre du "Thème de Deborah" d’Ennio Morricone côtoie "La Sicilienne" de Vivaldi et Bach, un "Intermezzo" de Brahms, une sonate de Scarlatti mais aussi les somptueuses "Barricades mystérieuses" de François Couperin.
Une pérégrination mêlant romantisme, classicisme, modernisme, audace, revisites et clins d’œil
Le contemporain a une place de choix avec Philip Glass ("I’m Going To Make A Cake"), Heitor Villa-Lobos ("Valsa da dor"), Arvo Pärt ("Pari intervallo") ou l’étude "Arc-en-ciel" de György Ligeti, un morceau aux envolées cosmiques, ponctuées de trouées sombres et de perles de pluie.
Serge Gainsbourg a même les honneurs de la pianiste : l’admirateur de Chopin et Sibelius apprécierait certainement. À ce sujet, les fans de Gainsbourg et de Jane Birkin auront très certainement deviné derrière le "Prélude en mi mineur" de Chopin le thème de "Jane B." Plus étonnant encore, Khatia Buniatishvili propose une 17e piste intitulée 4’33’’ : l’auditeur n’entendra aucun son de ce morceau de John Cage qui propose 4 minutes 33 de silence métaphysique !
La pianiste franco-géorgienne cache décidément bien son jeu : elle se fait également arrangeuse pour "La Sicilienne" de Vivaldi et Bach ou la célèbre "Badinerie" du Cantor de Leipzig, et même joueuse de jazz dans son adaptation de "La Javanaise" de Gainsbourg.
Khatia Buniatishvili sort indéniablement des sentiers battus avec cet album classique mais aussi très personnel, à l’image de son interprétation bouleversante et de son commentaire sur l’Adagio de Bach réarrangé par Alessandro Marcello, qu'elle commente ainsi : "Si elle n’avait pas été absente, elle aurait marché pieds nus sur la terre chaude, elle aurait pensé : « Le printemps d’un autre est agréable regarder aussi. »"
Khatia Buniatishvili, Labyrinth, Sony Classical, 2020
https://www.facebook.com/khatiabuniatishvili
http://www.khatiabuniatishvili.com
Voir aussi : "Le trio Sōra vous souhaite un joyeux anniversaire, M. Beethoven"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !