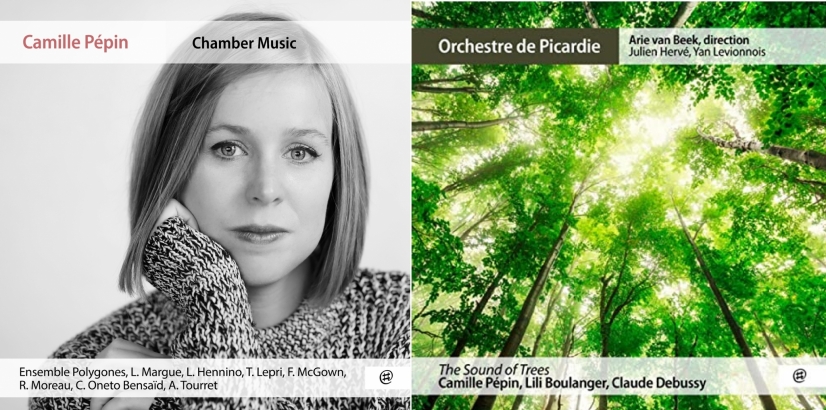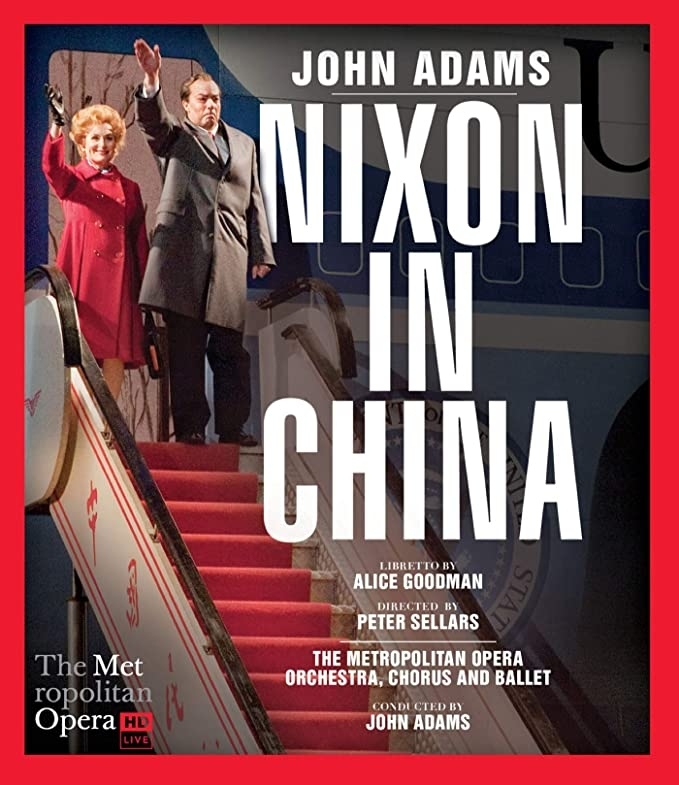Musique ••• Classique ••• Ludwig van Beethoven, Intégrale des Symphonies de Beethoven vol.2 : Symphonies n°5, 6 & 8
Michel Haillard virtuel

Il était question sur Bla Bla Blog, il y a quelques semaines, de l’exposition de Michel Haillard à La Cartonnerie.
Avec la crise sanitaire, l’artiste a choisi de s’adapter en proposant au public de découvrir ou redécouvrir son exposition à travers une visite virtuelle plus vraie que nature.
Figure atypique de l’art contemporain, Michel Haillard se décrit comme un "créateur d’univers." Ébéniste, tapissier, recycleur, amoureux de la nature et des animaux, il fait de ses œuvres des objets à la fois baroques, tribaux et organiques : un homme honorant le vivant, avec cet humour, cette technicité et cet enthousiasme qui sautent aux yeux.
L’ancien étudiant à l’École Supérieure des Arts Modernes créé des meubles aux noms évocateurs, puisant à différentes sources et différentes cultures : commodes "Karabosse", fauteuils "Platon" ou trônes "Perro." Les matériaux utilisés sont tout autant hétéroclites : bois, cornes et peaux (passées par les douanes, dont le permis CITES garantie la traçabilité), pierres précieuses et semi-précieuses, bronze, verre et bien d’autres éléments détournés. L’artiste est à la redécouverte des origines de l’homme, qui n’est rien s’il ne respecte pas son écosystème. Michel Haillard entend ainsi remettre le sauvage et l’art premier au cœur de la création contemporaine. Il nous rappelle que, chaman, animiste, prêtre ou devin, l’homme célèbre le dieu animal depuis la nuit des temps.
À la limite de la transe, Michel constitue une collection de pièces uniques à partir de grelots, ronds de serviettes, jouets, plumes ou dents de cochon sauvage… De tous ces objets et matières sont nés des parures de sorciers, des couvre-chefs "coiffinés", des masques, des lampes féeriques et autres
moulins de prière, que le Prince de New York exhiberait assis sur son trône d’alligator vermillon.
Cet univers et cette œuvre incroyable est à découvrir dès aujourd’hui. Et puisque, crise sanitaire oblige, les galeries sont fermées, c’est sur Internet que l’artiste propose de faire une visite virtuelle de sa dernière exposition.
Incroyable, unique et passionnant.
Michel Haillard, exposition virtuelle
"Danse avec les gnous, ou le rire du pangolin – Objets magiques made in confinement"
https://jevisite.art/le-rire-du-pangolin.html
http://www.michel-haillard.com
http://www.lacartonnerieparis.com
Voir aussi : "Michel Haillard, made in confinement"
"Païenne à Paris"
© Michel Haillard
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !