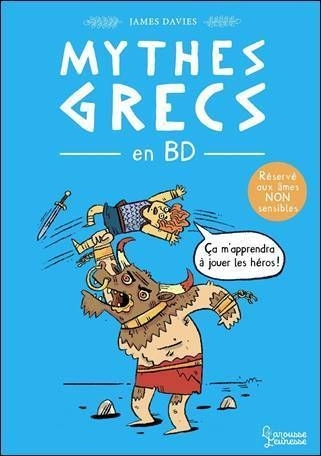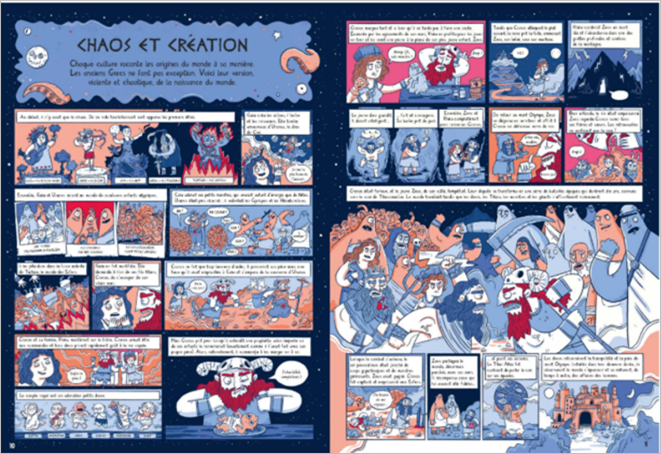Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage
Les Part-Time Friends se sont bien trouvés

Les Part-Time Friends sont des artistes que l’on a plaisir à suivre, en raison de leur électro-pop sans chichi, admirablement bien produite et qui vous caresse doucement les tympans.
Ils sortent ce printemps leur troisième album, Weddings & Funerals et continuent de tracer leur sillon. Le single phare de leur opus est "Paris en août", un titre qui n’est pas, contrairement à ce qu’on pourrait penser, une déambulation dans la capitale en plein été mais, comme ils le disent eux-mêmes, "une allégorie naïve du sentiment que l'on ressent quand on trouve le ou la bonne personne. Quand la ville se vide de son monde, sous un soleil radieux, et que le quotidien s'en retrouve sublime et sublimé."
Rencontrer la bonne personne, partager avec elle sa vie et ses passions : voilà qui doit forcément parler à Pauline et Florent, inséparables depuis 10 ans, et qui proposent avec "Weddings & funerals" un album personnel, attachant et au son acidulé. Ils le disent autrement : "Nos chansons sont des petits pansements pour l’âme. Nos textes parlent d’amour, de nos espoirs et de nos peurs… tous ces sujets qui comptent pour nous. Nous essayons de les exprimer avec des mots simples".
Inséparables depuis 10 ans
Dans un opus principalement en anglais et qui prouve les affinités des deux artistes avec la britpop ("Cold Hearts", "Looking Forward"), les Part-Time Friends chantent en français dans le morceau "Même si", qui peut se comprend autant comme une déclaration d’amour que comme un hymne du groupe : "Et si on est deux amis / Avec le temps on s’est compris..."
"Leave It All Behind" se présente comme une électro-pop enlevée et au son sophistiqué (on pense aussi à cet autre piste, "Sacrifice") et que l’on peut comparer avec le minimalisme bricolé de "2 AM" ou "Next Big Thing". C’est simple : il semble que nous nous baladions par moment dans la lo-fi des années 90, à l’instar du bien nommé "Sober".
À la recherche de nouveaux terrains de jeu, le groupe ose la ballade folk avec le délicat "Dad" mais aussi l’électro-world avec un texte espagnol ("Mariposas").
Les Part-Time Friends savent surprendre mais aussi séduire grâce à leur électro-pop séduisante et rafraîchissante.
Part-Time Friends, Weddings & Funerals, Un Plan Simple / Sony Music, 2021
https://www.facebook.com/theparttimefriends
https://www.instagram.com/parttimefriends
Voir aussi : "Amis pour la vie"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !