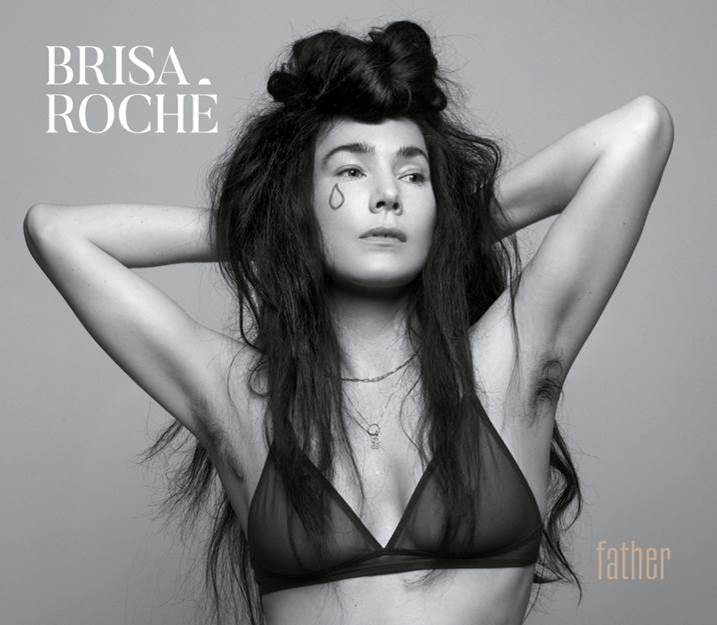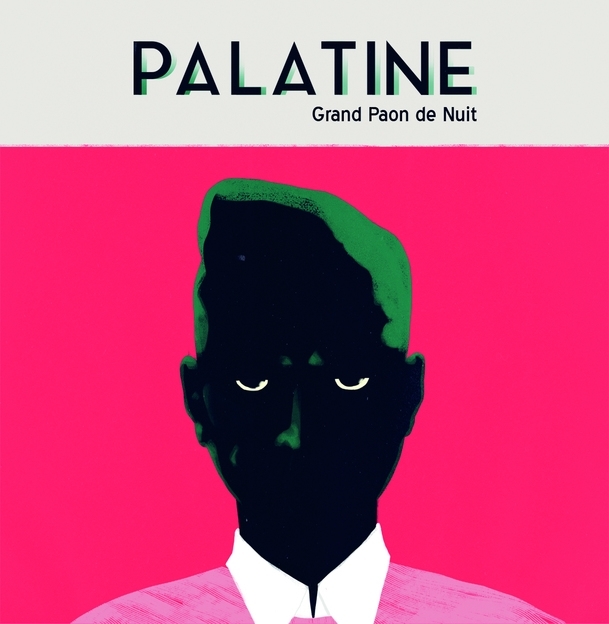Musique ••• Baroque ••• Claudio Monteverdi, L'Incoronazione di Poppea, Les Épopées
Seul en scène, entre amis

Le comédien Paul Morel est à l’honneur dans Ça aurait pu commencer comme ça !, une pièce écrite pour lui et mise en scène par son ami Julien Delpech. Ce spectacle marque les débuts de deux artistes à suivre. Il ne reste qu’une dernière représentation pour la découvrir, au Lycée Victor Duruy, Paris VIIe.
Ce seul en scène, une vraie performance en soi, promet une plongée séduisante dans le milieu du spectacle, comme dans la tête de ces artistes que Bla Bla Blog a plaisir à faire découvrir.
Paul Morel raconte l’histoire de Paul, cet autre que lui-même pour reprendre une citation de Proust, un jeune homme certain de son talent de comédien, mais qui finit par se saborder lui-même par manque de travail, de compassion et d’humilité.
Des changements de décors constants
Au sortir d’un one man show, Paul est remarqué par un producteur particulièrement élogieux. Fier, prétentieux, et surtout certain que le plus dur est fait, notre artiste en herbe perd toute crédibilité lors d’un rendez-vous organisé par le professionnel du spectacle. Dépité, le jeune homme part au vert à la campagne. Il y croise Pascal, modeste VRP qui, contre toute attente, vient faire de l’ombre à Paul.
Quatre chaises, une table et quelques éléments de costumes : la simplicité est l’arme pour cette comédie énergique où les changements de décors sont constants. On passe tour à tour d’une scène de stand-up à une loge, un salon ou une voiture. Le comédien seul sur scène change de costume rapidement, ne ralentissant pas le rythme d’une pièce que l’on devine très personnelle.
Deux amis qui montent seuls un spectacle sur le spectacle : voilà une intention séduisante et qui promet. Julien Delpech raconte ainsi l’écriture de cette pièce faite en étroite collaboration avec Paul Morel : "Le spectacle s’est créé de la manière suivante : j’ai d’abord proposé un schéma narratif à Paul, qui l’a approuvé… Le comédien pouvait alors à chaque fois suivre l’avancée de la pièce."
Ça aurait pu commencer comme ça ! développe avec une bonne dose d’humour des thèmes familiers dans le milieu du spectacle : l’art, la passion, le succès, l’ambition, les échecs et l’amour. Mais aussi l’amitié : l’œuvre de deux artistes que l’on imagine inséparables et qu’il va falloir suivre.
Ça aurait pu commencer comme ça !, de Julien Delpech, pour et avec Paul Morel,
Julien & Paul Productions
Dernière représentation de la saison le lundi 25 juin à 19h30, Lycée Victor Duruy, 19H30
33 Boulevard des Invalides, 75007 Paris