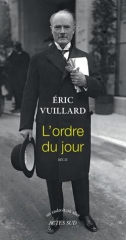Bande dessinée ••• Milo Manara, Le Parfum de l'invisible, Intégrale
Froides épurations

S’il y a un seul élément justifiant que l’on s’intéresse à Shadowplay c’est avant tout l’époque et l’année (1946) et la ville (Berlin) où se déroule ce polar (très) noir. Après l’excellentissime Babylon Berlin de l’entre-deux-guerres, Shadowplay fait un focus sur la ville allemande, mais cette fois quelques mois après la chute du nazisme et la fin de la seconde guerre mondiale.
Cette période est si peu connue qu’il semble qu’un voile pudique ait été jetée sur la courte période qui a marqué l’Allemagne en voie de dénazification – une "épuration" comme on l’a théorisé de ce côté-ci du Rhin. Berlin est coupée en quatre par les vainqueurs de la guerre, les États-Unis, l’URSS, la Grande-Bretagne mais aussi – curieux revers de l’histoire – la France.
L’Allemagne est le grand vaincu de la guerre : les nazis sont morts ou alors en fuite et la population a été saignée, spécialement du côté masculin, à telle enseigne que dans la série Shadowplay, l’unité de police que rejoint le policier américain Max McLaughlin (Taylor Kitsch) est dirigée et occupée majoritairement par des femmes. La tâche est évidemment ardue pour ces fonctionnaires catapultées là. Dès centaines de milliers de crimes sont commis chaque année dans l’ex et future puissance allemande et la pauvreté est à son maximum dans ce qui n’est qu’une ville en ruine.
Voilà pour le tableau. Un tableau incroyable où règnent mafias, luttes politico-militaires entre anciens alliés, petits et grands larcins, meurtres et impunités à tous les étages. L’Allemagne vaincue est plus qu’humiliée : punie, déchirée et réduite à l’état de non-nation et de chaos.
L’Allemagne punie et réduite à l’état de non-nation et de chaos
Max McLaughlin débarque de son Amérique natale après une enfance difficile et marquée par un crime familial, il vient officiellement aider la policière Elsie Garten (Nina Hoss) à organiser une unité de police allemande digne de ce nom. L'officier et ses agents n’ont que des barreaux de chaise en guise d’armes, avec une ancienne banque leur servant de commissariat de police. En réalité, Max est surtout à Berlin pour aller sur la piste de son frère qui a disparu à la fin de la guerre. Alors qu’un mafieux "recrute" des femmes désespérées et isolées pour ses affaires (prostitution, chantages et crimes en tout genre), un tueur en série s’attaque à d’anciens nazis et les tue au terme de longues agonies.
Shadowplay est une série historico-policière sur plusieurs niveaux : l’histoire personnelle de Max, d’abord, à la recherche de son frère. Disons que c’est l’aspect le moins intéressante de cette histoire, jusqu’à ce que les deux frères, nommés Max et Moritz – comme les deux personnages d’un classique de la littérature pour enfants – ne s’affrontent sur le terrain de la dénazification. Il y a également l’enquête autour du redoutable l’Engelmacher, le sinistre docteur Hermann Gladow (Sebastian Koch) et de son armée féminine que rejoint dès le premier épisode la troublante Karin Mann (Mala Emde). À cela s’ajoute une intrigue autour d’Elsie et de son mari prisonnier dans les geôles soviétiques.
Les personnages féminins sont au cœur d’une intrigue à double voire triple détente. Berlin repose sur elles, tout comme le crime comme le suggère la structure mafieuse du docteur Gladow. Nous ne serions pas tout à fait complet si on oubliait le personnage équivoque de Tom Franklin joué par Michael C. Hall (Dexter). Quant à, Tuppence Middleton, elle joue Claire Franklin, son épouse dans la série : une autre femme trouble, énième profiteuse autant que victime d’une guerre qui n’était pas encore froide.
Shadowplay, série franco-germano-canadienne de Måns Mårlind,
avec Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Logan Marshall-Green, Nina Hoss,
Tuppence Middleton et Sebastian Koch, Saison 1, 2021
https://www.canalplus.com/series/shadowplay
Voir aussi : "Crimes et chaos à Berlin"
"Les maîtres du ghetto"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !