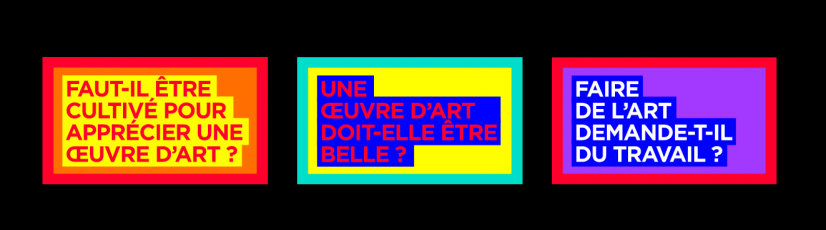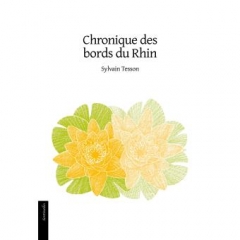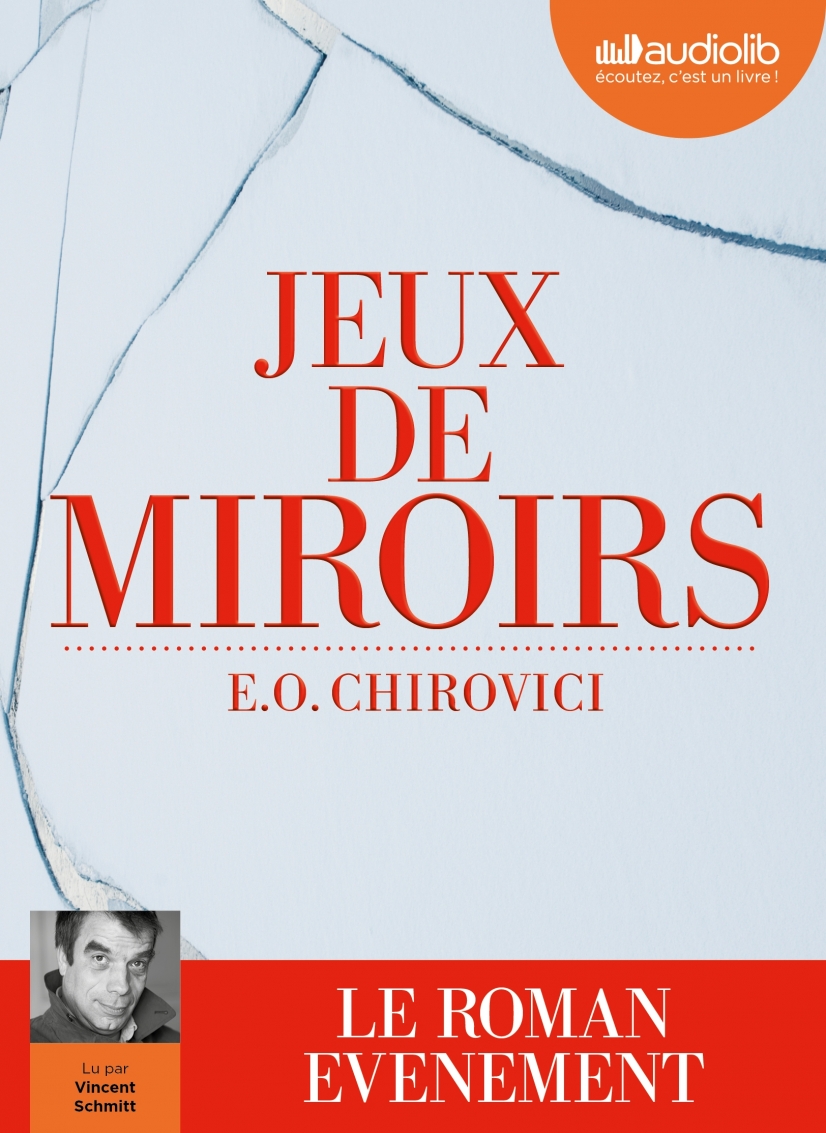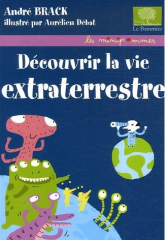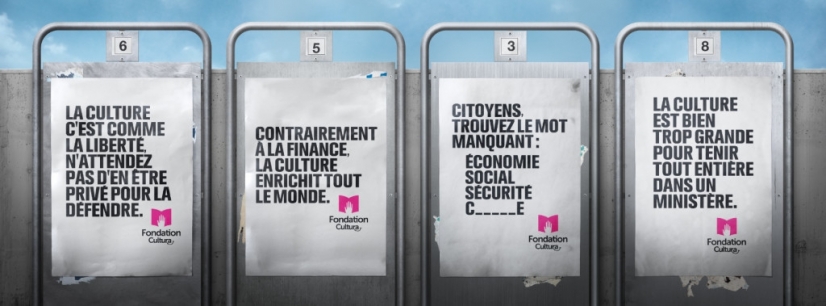Musique ••• Classique ••• De Grandval, Canal et Chaminade, L’âme résonnante, Hommage aux compositrices françaises
Au 21 rue la Boétie

Regardez cette petite fille au teint de porcelaine se fondant avec un haut de robe de la même couleur. Ses lèvres roses prononcées semblent répondre aux rayures du vêtement. Marie Laurencin représente l’enfant de face mais celle-ci ne regarde pas le spectateur. Elle fixe de ses immenses yeux bleus le sol, avec un mélange de timidité et d’intense concentration. Cette fillette, peinte par une artiste majeure du XXe siècle, s’appelle Anne Sinclair. Elle a quatre ans en 1952, lors de l’exécution de ce tableau, et appartient à la famille des Rosenberg. Son grand-père Paul Rosenberg (1881-1959) a été l’un des plus grands marchands d’art de la première moitié du XXe siècle et aussi le soutien d’un nombre importants de grands maîtres de l’art moderne : Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Henri Matisse et bien sûr Marie Laurencin.
Le Musée Maillol propose du 2 mars au 23 juillet 2017 l’exposition 21 rue La Boétie qui retrace l’histoire de cette aventure artistique, historique mais aussi familiale, à travers une impressionnante et émouvante exposition de 60 chefs d’œuvres issus de cette famille de collectionneurs d’art, à l’influence considérable.
Homme d’affaire avisé et amateur éclairé, Paul Rosenberg ouvre en 1910 sa galerie parisienne au 21 rue de Boétie :"Je compte faire des expositions périodiques des Maîtres du XIXe siècle et des peintres de notre époque" écrit-il à l’époque.
Ces maîtres du XIXe siècle, ce sont Renoir, Monet, Manet, Toulouse-Lautrec, Sisley et même Van Gogh qui ont été achetés par le premier collectionneur de la famille, Alexandre Rosenberg. Paul Rosenberg poursuit les acquisitions de son père en regardant d'abord du côté des impressionnistes, des représentants de l'école de Barbizon et de grandes figures du XIXe siècle. Le Musée Maillol consacre une salle dédiée aux œuvres d’Édouard Manet (La Sultane, v. 1871), de Renoir (Le Poirier d'Angleterre, (1873) ou une marine précoce de Claude Monet (Bateaux de Honfleur, 1866).
Mais c'est dans l'art moderne que l'influence des Rosenberg va s'avérer décisive, grâce notamment à Léonce Rosenberg (1878-1947). Passionné de cubisme et d'abstraction, le frère de Paul ouvre sa galerie, rue de la Baume, à Paris. La première guerre mondiale ouvre des perspectives inattendues pour les deux frères. Jusqu'en 1914, le marchand d'art allemand Daniel-Henry Kahnweiler avait pris sous son aile plusieurs pointures de l'art cubiste. La Grande Guerre impose son départ du sol français, si bien que, orphelins de leur soutien et protecteur, c'est naturellement vers les Rosenberg que se tournent les modernes.
 En quelques années, non content d'acquérir une collection d’œuvres majeures, la famille tisse des liens professionnels, artistiques mais aussi personnels avec ces artistes. Ainsi, Pablo Picasso, intime des Rosenberg, représente Micheline Rosenberg dans une toile (Mademoiselle Rosenberg, 1919) qui marque le retour du peintre d'origine espagnole à la figuration. Marie Laurencin, l'ancienne maîtresse et muse de Guillaume Apollinaire, sera un membre à part entière du cercle privé, jusqu'à faire poser la petite-fille de Paul (Anne Sinclair à l'âge de quatre ans, 1952). L'exposition a, entre autres, le mérite de présenter un nombre significatif de cette artiste trop mal connue : Les Deux Espagnoles (1915) ou La Répétition (1936).
En quelques années, non content d'acquérir une collection d’œuvres majeures, la famille tisse des liens professionnels, artistiques mais aussi personnels avec ces artistes. Ainsi, Pablo Picasso, intime des Rosenberg, représente Micheline Rosenberg dans une toile (Mademoiselle Rosenberg, 1919) qui marque le retour du peintre d'origine espagnole à la figuration. Marie Laurencin, l'ancienne maîtresse et muse de Guillaume Apollinaire, sera un membre à part entière du cercle privé, jusqu'à faire poser la petite-fille de Paul (Anne Sinclair à l'âge de quatre ans, 1952). L'exposition a, entre autres, le mérite de présenter un nombre significatif de cette artiste trop mal connue : Les Deux Espagnoles (1915) ou La Répétition (1936).
Léonce ouvre les collections familiales au cubisme, contribuant à défendre avec pugnacité cet art, décrié à l'époque. Le Musée Maillol présente, dans plusieurs salles, un choix représentatif d'acquisitions : Georges Braque (Nu couché, 1955), Fernand Léger (Composition, 1929) et bien entendu Picasso (Guitare sur tapis rouge, 1922). Le surréalisme n'est pas absent (André Masson, Enlèvement, 1931) et l'avant-garde est mise en avant (Henri Matisse, La Leçon de Piano, 1923). Marchand d'art, Paul Rosenberg entend être un découvreur de talents, tout autant qu'un passeur auprès du public. Voilà ce qu'il écrit en 1941 à ce sujet : "Les peintures en avance sur leur époque n’existent pas. C’est le public qui est parfois à la traîne de l’évolution de la peinture. Combien d’erreurs ont été commises, combien de jeunes futurs grands peintres ont connu la misère à cause de l’ignorance des marchands et leur refus de les soutenir, tout simplement parce qu’ils n’aimaient pas cet aspect de leur art ou parce qu’ils ne les comprenaient pas ! (…) Trop souvent, le spectateur cherche en lui-même des arguments contre leur art plutôt que de tenter de s’affranchir des conventions qui sont les siennes."
Passionné et rigoureux, Paul Rosenberg met en place un système pour essaimer ses idées de progrès. Il pressent très tôt l'importance du marché américain et choisit de s'associer avec Georges Wildenstein (1923). Il conseille des musées parisiens et provinciaux, édite des catalogues, cartographie, photographie et indexe avec précision ses œuvres, s'intéresse à la publicité dans les journaux et bien entendu achète, achète et achète ! Anne Sinclair écrit ceci : "Comme l’a souligné de nombreuses fois la presse américaine, Paul fut, jusqu’à la guerre, le plus grand marchand en Europe, de Delacroix à Picasso. « Imaginez, racontait un grand journal californien dans les années quarante, être capable d’entrer dans le studio de Matisse ou de Picasso deux fois par an, de regarder quarante de leurs meilleures toiles et dire “je les prends toutes” ! Jusqu’à la guerre, c’est ce que faisait Paul Rosenberg. »" Le musée Maillol a eu l'idée astucieuse d'entrer virtuellement dans la galerie du 21 rue La Boétie, via le système ancien et remis au goût du jour des jumelles à diapositives, que beaucoup ont expérimenté durant leur enfance. Les photographies en noir et blanc de la galerie Rosenberg dévoilent un lieu d'une richesse incomparable qui ne survivra pas à la seconde guerre mondiale.
 Une salle passionnante, moins artistiquement qu'historiquement, plonge dans les années sombres de l'Occupation. Dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, apparaît la notion politique et idéologique "d'art dégénérée" (Entartete Kunst). La double exposition de Munich en 1937 s'attaque à l'art moderne, émancipé et novateur (James Ensor, La Mort et les masques, 1897). Plus de 20 000 œuvres sont mises au pilori, lorsqu'elles ne sont pas détruites. Une certaine esthétique aryenne, figurative et valorisant la culture et le peuple allemands est utilisée à des fins de propagande. Le pouvoir nazi encourage une imagerie traditionnelle et volontairement apaisante : paysages bucoliques de Robert Streit (Matin d'été, avant 1944) ou Franz Marc (Chevaux au pâturage, 1910), jeunes allemandes idéalisées (Alfred Höhn, Jeune femme, v. 1939), paysans traditionnels allemands magnifiés (chez Julius Paul Junghanns), scènes mythologiques ou vues modernes de villes idéales (Albert Hirsh, Retour de la flotte, v. 1939).
Une salle passionnante, moins artistiquement qu'historiquement, plonge dans les années sombres de l'Occupation. Dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, apparaît la notion politique et idéologique "d'art dégénérée" (Entartete Kunst). La double exposition de Munich en 1937 s'attaque à l'art moderne, émancipé et novateur (James Ensor, La Mort et les masques, 1897). Plus de 20 000 œuvres sont mises au pilori, lorsqu'elles ne sont pas détruites. Une certaine esthétique aryenne, figurative et valorisant la culture et le peuple allemands est utilisée à des fins de propagande. Le pouvoir nazi encourage une imagerie traditionnelle et volontairement apaisante : paysages bucoliques de Robert Streit (Matin d'été, avant 1944) ou Franz Marc (Chevaux au pâturage, 1910), jeunes allemandes idéalisées (Alfred Höhn, Jeune femme, v. 1939), paysans traditionnels allemands magnifiés (chez Julius Paul Junghanns), scènes mythologiques ou vues modernes de villes idéales (Albert Hirsh, Retour de la flotte, v. 1939).
Le Musée Maillol rappelle un événement peu connu du grand public mais à la portée artistique, éthique et symbolique peu commune : la vente à Lucerne en 1939 de 125 œuvres "dégénérées" (109 tableaux et 16 sculptures) accaparées par les nazis. Y figurent des peintures de Fernand Léger (Trois femmes, Le grand déjeuner, 1921-1922) ou Oskar Kokoschka (Monte-Carlo, 1925). Le monde de l'art se déchire sur la question d'acheter ou non des peintures et des sculptures exceptionnelles pour les sauver, ou, plus cyniquement, enrichir une collection. Paul Rosenberg refuse catégoriquement de participer à cette vente.
Suite à la défaite française, Paul Rosenberg, marchand d'art d'origine juive en vue, doit quitter la France. Il finit par atterrir aux États-Unis et ouvre en 1941, à New-York, une nouvelle galerie, au 79 East 57th Street. Auparavant, il a essayé de mettre à l'abri quelques-unes de ses toiles (Nature morte à la cruche et Baigneur et baigneuses de Picasso), en vain : le coffre-fort à Libourne où il pensait avoir mis à l'abri ses tableaux les plus précieux est récupéré par l'armée allemande.
À Paris, la galerie du 21 rue La Boétie est fermée, réquisitionnée par les autorités et devient - ironie du sort - l’Institut d’Études des Questions juives. Anne Sinclair écrit ainsi de cette période : "Le 4 juillet 1940, Otto Abetz, l’ambassadeur du Reich à Paris, adressa donc à la Gestapo la liste des collectionneurs et marchands juifs les plus connus de la place : Rothschild, Rosenberg, Bernheim-Jeune, Seligmann, Alphonse Kann, etc. C’est dès ce jour-là que l’hôtel du 21 rue La Boétie aura été perquisitionné, avec saisie des œuvres d’art que Paul avait laissées, d’une bibliothèque de plus de mille deux cents ouvrages, de l’équipement de toute une maison (des meubles anciens aux accessoires de cuisine), de plusieurs centaines de plaques photographiques et de toutes les archives professionnelles de la galerie depuis 1906. Figuraient aussi des sculptures, restées à Paris car difficilement transportables – dont un grand Maillol, et les deux statues célèbres de Rodin, Eve et L’Age d’airain, qui ornaient le hall de la rue La Boétie."
 Avec la Libération s'ouvre l'étape compliquée de récupération des œuvres spoliées. Cette période dure encore aujourd'hui, 70 ans plus tard. Très vite, les alliés se sont intéressés au pillage par les nazis des musées et des collections privées. À l'été 1944, le train 40044 à destination de la Tchécoslovaquie est détournée par la Résistance. Elle y récupère 967 œuvres d'art. L'organisateur, Alexandre Rosenberg, a la surprise de découvrir dans ce stock des tableaux de son propre père !
Avec la Libération s'ouvre l'étape compliquée de récupération des œuvres spoliées. Cette période dure encore aujourd'hui, 70 ans plus tard. Très vite, les alliés se sont intéressés au pillage par les nazis des musées et des collections privées. À l'été 1944, le train 40044 à destination de la Tchécoslovaquie est détournée par la Résistance. Elle y récupère 967 œuvres d'art. L'organisateur, Alexandre Rosenberg, a la surprise de découvrir dans ce stock des tableaux de son propre père !
Les années suivantes, ces marchands d'art n'auront de cesse de récupérer leur bien. De nombreux tableaux, disparus puis sauvés par les Rosenberg, sont exposés au Musée Maillol : le fameux Baigneur et Baigneuses de Pablo Picasso (1920-1921), ou Profil bleu devant la cheminée de Matisse (1937).
La seconde guerre mondiale aura finalement mis à mal durablement la capitale parisienne du marché de l'art. À partir des années 50, c'est aux États-Unis, et plus en Europe, que se fera la pluie et le beau temps dans l'art moderne. La dernière salle de l'exposition est consacrée aux années américaines de Paul Rosenberg, marquées par l'exposition itinérante consacrée à Aristide Maillol de 1958 à 1960. Rien d'étonnant que près de 60 ans plus tard le Musée Maillol ouvre à son tour ses portes à l'une des plus belles collections d'art moderne, sous le regard bleu et chavirant de la petite Anne peinte par Marie Laurencin.
21 rue La Boétie, Musée Maillol, du 2 mars au 23 juillet 2017
http://www.museemaillol.com
Anne Sinclair, 21 rue la Boétie, Paris, éd. Grasset, 236 p., 2012
Marie Laurencin, Anne Sinclair à l’âge de quatre ans, 1952, Huile sur toile, 27 x 22 cm, Collection particulière © Fondation Foujita / ADAGP, Paris, 2016
Georges Braque, Nu couché, 1935, Huile sur toile, 114,3 x 195,6 cm, Collection David Nahmad, Monaco
Pablo Picasso, Nature morte à la cruche, 19 avril 1937, Huile sur toile, 46,3 x 64,8 cm,
Collection David Nahmad, Monaco. © Succession Picasso © Photo: Collection David Nahmad, Monaco
Pablo Picasso, Baigneur et baigneuses (Trois baignants), 1920-1921, Huile sur toile, 54 x 81 cm
Collection David Nahmad, Monaco. © Succession Picasso © Photo: Collection David Nahmad, Monaco