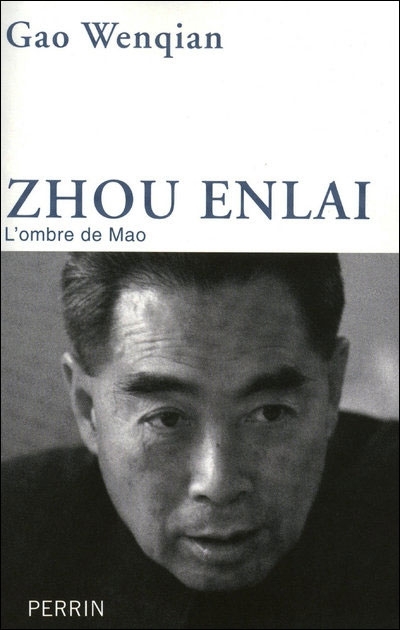Puisque l'on est entre nous, je dois vous avouer que Marie Cherrier fait partie depuis longtemps des auteurs dont je voulais parler sur ce blog. Elle est ce genre d'artiste qui vous accompagne des années durant, offrant une présence rassurante et revivifiante. Voilà donc cet article, voilà Marie, alors que sort en ce moment son quatrième album studio, L'Aventure.
Comment pourrait-on ne pas l'aimer, elle, son opiniâtreté à creuser son sillon artistique, son sens de l'écriture, ses saynètes (Le Curé, 7ème Ciel ou Café noir), ses mélodies et ses interprétations sensibles ? La chanteuse poursuit son petit bonhomme de chemin, suivie par un public de fidèles, sans nier la difficulté à imposer son choix artistique : "La poésie est à la rue, tant mieux. Que la télé d’aujourd’hui la boude est un certificat de noblesse. Dans ce camp je n’y suis ni par dépit, ni par calcul c’est sûr…, mais pour l’honneur" écrit-elle dans "Ils sont drôles eux", un billet paru sur son site.
C'est loin des majors de disques, des télé-crochets, des impératifs commerciaux et de la facilité que Marie Cherrier travaille avec justesse ses textes et ses musiques, avec un style bohème (la parenté avec Zaz n'est pas absurde) et une voix assez proche de celle de Vanessa Paradis. Dans son premier disque, Ni Vue Ni Connue (2004), l'univers de Marie Cherrier était déjà là, tout entier : liberté revendiquée, orchestration acoustique, chansons denses, voix délicate.
S'il n'y avait qu'un album pour découvrir cette chanteuse originaire du Loir-et-Cher, je conseillerais son concert capté à La Cigale en 2008 (Live à La Cigale). On y retrouve les titres les plus représentatifs de Marie Cherrier : 7ème Ciel, La Funambule, Les Baleines, Le Curé, Marchand d'froufrous, Tourterelle, Les Pattes du Loup et surtout Le Temps des Noyaux. Ce titre sur les horreurs de la première guerre mondiale n'a pas été pour rien dans la notoriété de Marie Cherrier : "Alors là-d'ssus j'rejoint Prévert / L'temps des cerises ce que ça vaut / Quand la chair est tombée par terre / Démerde-toi avec les moineaux / Ces dames ont un chemin qui mène / A la mort pour les clafoutis / Imagine le tronche des gamelles / Gare aux quenottes, plantez les p'tits."
Texte d'une incroyable puissance poétique, mélodie entêtante et voix posée avec justesse ont concouru à la reconnaissance d'une toute jeune artiste par le public, comme par ses pairs (que ce soit Francis Cabrel, Juliette Gréco ou Hubert-Félix Thiéphaine). Dans l'album Alors Quoi ?, son deuxième disque, un autre titre se distingue : Ben Alors Quoi ? Cette fois, la chanteuse fait un hommage autant qu'un portrait à charge de Renaud : " Je t'regrette le chanteur énervant / Bon, t'as le droit d'plus être énervé..." Un autre titre se dégage de cet opus, Pas d'ma Faute, une confession autobiographique sur une jeune femme revendiquant sa simplicité et sa vie ordinaire : "Je n'serai jamais le sujet d'une / Biographie et j'le regrette, / Je n'ai pas eu mauvaise fortune / dans le passé, faut qu'j'vive avec / Sûr que je manque d'intérêt / puisque je n'suis pas orpheline, / Puisque j'n'ai pas été trouvée / étant petite dans les épines..."
En 2013, c'est épaulé par Michael Désir, un batteur expérimenté (il a travaillé avec Ayo ou Kéziah Jones) que Marie Cherrier propose un nouvel album, Billie, Billie n'étant autre que son double : "Voilà Billie avec ses grenades / Ses barricades / Ses injures au Monde entier / Mais Billie la haine en rade / V'là la paillarde / Amoureuse à ce qu'il paraît..."). Je dois avouer que j'ai été moins enthousiaste pour ce nouveau enregistrement : plus enlevé et puisant dans des styles variés (rock, folk, coupé-décalé, pop, country, etc.) il me semble ne pas refléter exactement l'originalité de l'auteure, sauf lorsque cette dernière revient à des titres plus acoustiques. Ainsi, T'es Où ? n'est pas sans rappeler son apostrophe à Renaud, même si cette fois la chanteuse en appelle plus généralement au retour de la révolte et de l'engagement ("T'es où ? Parce que là, ça va pas. / Des Fantômes me hantent la Tête / Des Gandhi, Colucci, / Des poètes/ Des bandits honnêtes / Qui sauvaient la vie...")
En 2015, voilà Marie avec un nouvel album, L'Aventure, distribué loin des grands réseaux, avec passion mais non sans cet esprit de révolte : "Ils sont drôles eux… Mais enfin plus personne ne sait ce qu’est la lutte dans ce foutu métier ? Ils me disent de faire des reprises, qu’y a plus de subventions pour la chanson… Que le marché a changé…"
Sinon, nous rassure-t-elle, tout va bien pour elle, merci ; et pour nous aussi, du coup.
Marie Cherrier, L'Aventure, 2015
http://mariecherrier.com
Tout sur un plateau 03/04/15 Troisième Partie par tvtours