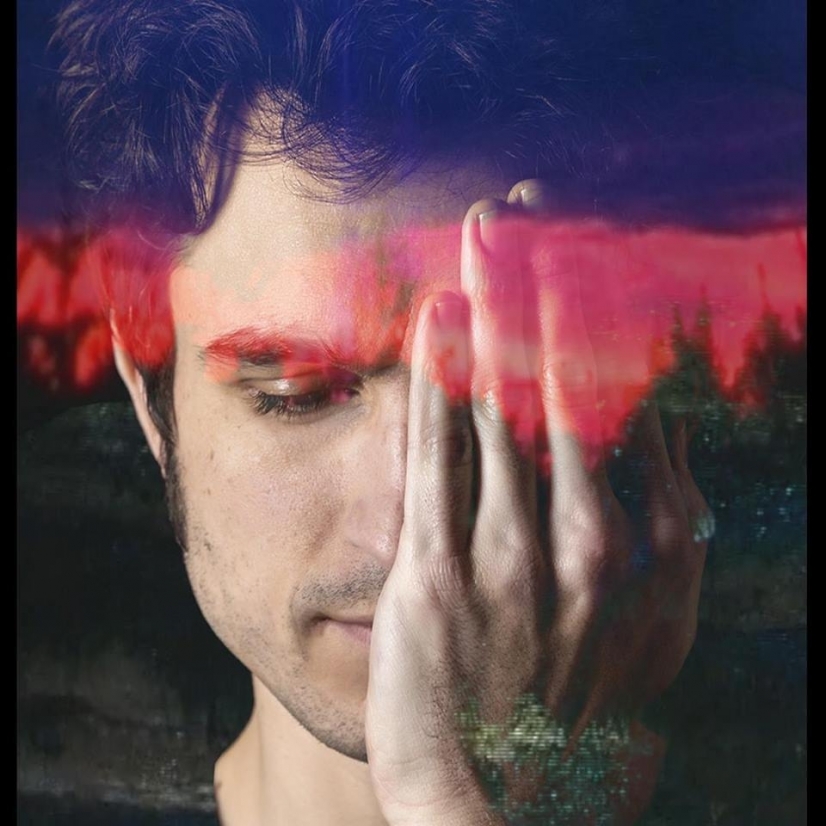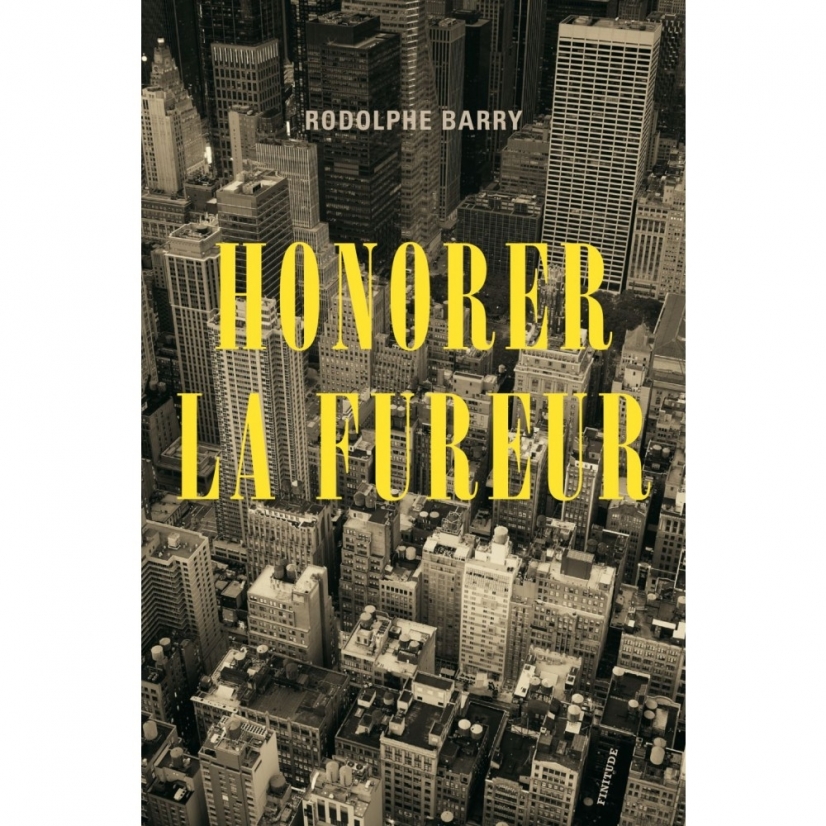Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage
Une scène très Ikea dans Fight Club
Focus cette semaine grâce à L’Œil du frigo d'un film culte : Fight Club de David Fincher s'est imposé comme un drame social complexe et aux multiples interprétations. Philippe, notre chroniqueur de L’Œil du frigo explique pourquoi le frigo a une vocation scénaristique plus pointue qu'il n'y paraît.
Voici une scène de frigo, encore une fois dans un film de David Fincher – souvenez-vous de Seven. Ici, dans Fight Club, le frigo est un point essentiel : on le voit très légèrement mais il va obliger Edward Norton à déménager. C'est dire l'importance d'un frigo, du destin.
J'aime cette scène "Ikea". Evidemment, on est complètement hypnotisé par les meubles qui s'installent dans l'appartement vide. On aimerait bien d'ailleurs que nos meubles Ikea s'installent aussi bien. Plissez un peu les yeux et cherchez l'essentiel de cette séquence. Edward assis sur son trône, feuillette son catalogue puis remonte toutes les pièces, comme une lente digestion (voire régurgitation) : direction le frigo. Bref, pour résumer, avant d'ouvrir cette foutue porte de frigo, on remonte les parois intestinales du bel Edward. Je sais c'est un peu scato, mais cette vomissure commence par le début, l'ouverture de la porte du frigo et le choix de la nourriture. On est en plein dans le film. On part des toilettes pour aller jusqu'au Frigo. L'inverse aurait été plus normal même si je ne suis pas un grand gastro-entérologue. La décomposition remonte le temps et atterrit au point de départ le Frigo !
Non ne soyez pas si dégoûté, à ce moment-là du film tout est encore soft... À l'ouverture de ce frigo, qui ne semble pas avoir été vendu par Ikea, on note bien qu'il n'y a rien dans le frigo, ou presque. Edward est désemparé. En haut, une pomme et une poire. En dessous, un vieux bout de fromage, deux pots bizarres. Et tout en dessous, du lait. Le plan ne s'élargit pas : il tourne et là – oh miracle ! – nous tombons sur des pots de confiture ou des pâtes chocolatées. À noter quand même qu'il y a un vieux poivron vert à côté d'un pot de beurre. On se demande qui a bien pu ranger le frigo : quel bazar...
Oui, Fincher adore les frigos : il y synthétise la paroi de ses films. Enlevez une pomme de son frigo et c'est un autre film... Essayez chez vous et vous aurez une autre vie. Là, je me sens à fond pour vous parler du destin, du yi-jing, des folies de votre corps : bref de toute une vie autour de l'objet "frigo". Bon, le film est bien "dark" et le personnage féminin Marla (Helena Bonham Carter) est bien barré. Je ne vous la décriai pas mais elle vaut son pesant de noirceur.
Une phrase résonne encore dans mon cerveau pour vous situer l'espace frigidaire dans lequel on se situe : "On a frôlé la vie", dixit Tyler (Brad Pitt, le gourou du fight club). Et là, vous foncez dans votre frigo virer une pomme, histoire de changer le destin.
ODF
Fight Club, drame de David Fincher
avec Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter
Etats-Unis, 1999, 139 mn
Voir aussi : "L’Œil du Frigo débarque sur Bla Bla Blog"
"Fight Club Frigo"
Tenez-vous informés de nos derniers blablas
en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.
Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !